Université de Dakar. Institut Fondamental d'Afrique Noire
Collection Initiations et Etudes Africaines. N°XXV. Dakar. 1969. 250 p.
La langue toucouleur traduira la notion de parenté soit au moyen de banndiraagal, soit encore par le truchement de jiidigal, dernier vocable plus usité parce qu'il cerne plus concrètement le lien familial entre les personnes. Quant au concept de famille, il sera généralement figuré par le terme galle (habitation, maison). C'est là une évidente primauté de l'aspect spatial, à savoir que les membres d'une famille au sens large étaient groupés dans la même demeure, le même galle, initialement à tout le moins.
Toutefois, pour écarter la confusion et donner au mot sa véritable signification familiale, il sera courant d'adjoindre à galle son déterminatif, en l'espèce l'anthroponyme ou bien le patronyme du fondateur : l'on dira galle Tapsiiru Amadu Hamat, ou bien galle WanwanBe. Cette dernière expression sera comme une totalisation de la lignée des Wan, ce qui correspond bien à la manière toucouleur, qui. est d'entendre famille au sens global du terme, à savoir les vivants comme les morts, tous les descendants de l'ancêtre le plus reculé, d'où le mot galle suivi régulièrement du nom de cet ancêtre-souche.
Galle peut également être pris dans une acception restreinte, et désigner nommément tel foyer concret. Il sera alors sous entendu que ce foyer est partie intégrante d'un galle mawDo d'origine, ou famille étendue qui s'est diversifiée en de nombreux ménages (fooyre-pooye), dont tous les chefs subissent l'autorité d'un doyen-patriarche honoré du titre de joom ou ceerno, en tant qu'il est le véritable et le seul chef de la famille globale, singulièrement en matière de propriété des terres et mariage des enfants. En fait, toute pluralité apparente des galleeji dans un quartier de village ou plusieurs villages, voire des régions différentes du Fouta, est réductible à un nombre limité de familles originelles.
La parenté toucouleur sera envisagée, d'une part, comme terminologie, à savoir les différentes appellations ou, formes de parenté, d'autre part et conjointement, en tant qu'elle est système de croyances traditionnelles et d'attitudes interpersonnelles.
Autrement dit, quelles structures de parenté sont fondamentales de la collectivité toucouleur, et quels rapports sociaux procèdent de ces structures ?
Il n'est peut-être pas invraisemblable que l'application de la coutume consistant à se marier très jeune (resde law) — et lorsque ladite coutume se trouve heureusement secondée par un taux de natalité supérieur à celui de la mortalité (galle BesDo) — ait permis à quelques familles de voir coexister en leur sein les quatre générations successives des njaatiraaBe, taaniraaBe, jinnaaBe et BiBBe, soit respectivement les arrière-grands-parents, les grands-parents, les parents et les enfants. Il est cependant clair que la coexistence de ces quatre générations ne saurait être que limitée en durée, pour le njaatiraaDo à tout le moins. Dans la famille courante, en effet, la génération la plus ancienne sera presque toujours constituée par les taaniraaBe. Les éventuels njaatiraaBe sont plutôt rares et forcément connus dans plusieurs villages à la ronde, parce qu'il s'agit généralement de ces cas de longévité exceptionnelle, tout à la fois socialement enviés et redoutés. Car, si l'on souhaite de vivre longtemps ce n'est guère pour atteindre à ce stade du njaatiraaDo, où presque toujours l'on devient le dernier être vivant de sa génération (teelDo ou mo ala giJum), un être dont la personnalité apparaît souvent dissocié (hoore heli). Et, précisément, si ce dernier inconvénient est assumable sans grand dommage, en revanche il ne sera pas songé au premier sans une certaine mélancolie. Survivre à toute sa génération, n'est-ce pas plutôt que bénédiction réelle malédiction, car c'est la position du patriarche solitaire dorénavant privé de toute influence sur sa descendance, parce que dépourvu des moyens physiques et intellectuels nécessaires. Le patriarche vit dans une case retirée où sa famille le tient cloîtré, par crainte de le voir fuguer ou s'abandonner en public, et « faire honte ». Cette même famille fera parfois durement sentir à son njaatiraaDo combien elle éprouve de déplaisir à regarder son existence se traîner indéfiniment. Et même sans tout cela, est-ce que le njaatiraaDo ne s'éprouve pas comme un être parfaitement marginal, sans aucun giJiraaDo avec qui communier, ou seulement converser, sinon évoquer le passé ?
Sans nul doute, le njaatiraaDo est une personne qui se rencontre assez peu fréquemment. Quant aux autres ascendants qui le précèdent dans la chronologie, de toute évidence ils sont toujours au passé, et tellement éloignés que la langue ne semble pas avoir jugé utile de se donner des concepts originaux pour les nommer, en les situant à leur rang précis dans la succession des générations. En effet, njatan njaatiraaDo figurera tant bien que mal l'arrière-arrière-grand-parent, tandis que keltinofel 1 indiquera très approximativement autant l'arrière-arrière-grand parent que tous les ascendants de celui-ci, jusques et y compris l'ancêtre-souche. Cette dénomination de kelti nofel apparaîtrait donc comme la limite de conceptualisation de l'ascendance, mais c'est une limite si peu définie qu'elle nécessite une série d'expressions combinées pour y suppléer. Ainsi, il semblera toujours possible de nommer la génération pour éloignée qu'elle soit : par exemple, njatum njaatiraaDo 2 ou arrière-grand parent de l'arrière-grand parent. Encore, le problème demeurerait-il entier de traduire dans une seule expression, sans nuire à la clarté, à la fois la génération et le sexe, comme par exemple arrière-grand mère maternelle de l'arrière-grand-père paternel. Les risques d'erreur et de confusion apparaissent tellement grands, qu'il semble préférable de s'en tenir à la connaissance des trois générations les plus rapprochées (arrière-grands-parents, grands-parents et parents), le nombre de personnes qui les constituent n'étant pas, au demeurant, chiffrable sans beaucoup de peine. Quant à ce qui est de remonter à l'ancêtre-souche, cela est généralement laissé à la compétence du griot-généalogiste 3. Mais il ne sait pas davantage conceptualiser, usant d'une méthode pour ainsi dire concrète, qui consiste à mentionner nommément les personnes dans l'ordre même de leur succession à l'intérieur de la lignée. Il s'agit d'une relation binaire uniquement, à savoir un(e) tel(le) fils (ou fille) d'un(e) tel(le) (kaari jibini kaari), le second terme de chaque relation précédente devenant le premier de la suivante, et ainsi de suite jusqu'au descendant ultime, qui est également l'aboutissement provisoire de la lignée. Cependant, la généalogie non seulement n'offre aucune conceptualisation de l'ascendance éloignée, mais elle est en outre plutôt confuse dans la pensée de ses auteurs habituels, Les griots, en effet, parce qu'ils procèdent à une généalogie parlée, se répètent souvent et donnent l'impression de débiter une litanie dépourvue de toute signification pour le non initié.
Pourtant, cette indigence réelle du vocabulaire de la parenté — relativement à l'ascendance éloignée — cadre plutôt mal avec l'importance accordée à cette même ascendance dans le devenir individuel de chaque personne. La fonction dévolue aux origines est capitale, la conception commune étant d'estimer, voire de surestimer l'héritage historique. Il y aurait même un véritable délire de l'ascendance illustre chez le Toucouleur, et l'on ne verra nul inconvénient à intégrer des ancêtres parfaitement obscurs à un lignage notoire à plus d'un titre, parce qu'il est coutumier de dire de ses représentants qu'ils ont défendu une ou plusieurs vertus cardinales du groupe, comme la sagesse, la piété, la puissance, l'héroïsme, l'hospitalité et le savoir koranique selon une formulation devenue célèbre : o wya ceerno, o juulni jumaa ; o wya alfa, o nyaawi Ngenaar, o wya almaami, o laami Futa fof 4, à savoir respectivement le savant iman, jurisconsulte, chef local et maître de toutes les provinces du Fouta Tooro.
En fait, si éloignée qu'apparaît l'ascendance elle est fatalement censée imprimer sa marque au descendant. L'ascendance illustre (joom lasli ou joom asko), c'est le succès social évident pour le descendant, parce que « bon sang ne saurait mentir ». Pour le succès de la personne dont l'ascendance est complètement dénuée de lustre, c'est l'unique bonté divine (dokke Allah) qui opère, ce mystère impénétrable qui est aussi la clé de tous les mystères.
La figure 1 qui est la représentation des relations ancêtres-descendants, apparaît de toute évidence schématisée à l'extrême, car les nombreuses ramifications du lignage considéré s'en trouvent exclues. C'est ainsi que pour chaque génération considérée un seul descendant mâle est figuré, représentant le fils aîné de la première épouse, à l'exclusion complète de ses frères et sœurs, ces dernières étant d'ailleurs écartées par le fait même de la filiation patrilinéaire.
Le tableau 1 permet de connoter les relations réciproques des différents paliers de l'ascendance-descendance, et indique la méthode pour remonter jusqu'à l'ancêtre-souche, en partant d'une génération quelconque. Par exemple, l'on a :
E. BiDDo de F — jinnaaDo de D — taaniraaDo de C — njaatiraaDo de B — njatan njaatiraaDo de A.
D. BiDDo de E — jinnaaDo de C — taaniraaDo de B — njaatiraaDo
C. BiDDo de D — jinnaaDo de B — taaniraaDo de A.
B. BiDDo de C — jinnaaDo de A.
A. BiDDo de B — taaniraagel [5] de C — njaatiraagel de D — njalan njaatiraagel de E.
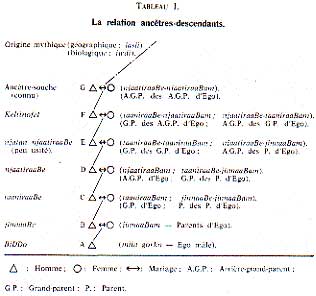
Le palier central C va être examiné plus directement, afin d'en analyser la structure d'ensemble. Quelles personnes sont admises au titre des taaniraaBe, à savoir les grands-parents réels comme classificatoires ?
1. Les taaniraaBe
La qualité de taaniraaDo ou aïeul s'applique dans un cadre familial restreint à tout jinnaaDo de jinnaaDo. Au plan de la collectivité générale (quartier ou village), le cercle des taaniraaBe est en revanche extensif à beaucoup d'autres individus.
Les taaniraaBe au sens social et familial, avec prédominance de celui-ci, sont les frères, soeurs, cousins et cousines — quel que soit leur âge — de chacun des quatre grands-parents. Cette disposition se traduit dans le titre de grand-père attribué par des adultes au simple jeune homme imberbe, qui n'est manifestement pas encore jinnaaDo, mais cependant excipe de la qualité de cousin consanguin authentique du grand-père effectif. De la même manière, la fillette dont la nubilité reste éloignée peut voir marquer un semblant de déférence et reconnaître la qualité de maama par des personnes fort âgées.
Les taaniraaBe au simple sens social sans considération pour la caste ou le sexe, sont tous les giJiraaBe (même âge) des grands-parents, à savoir leurs associés habituels dans cette classe distincte qu'ils constituent et dont le rôle est fixé lors de chaque événement mobilisant la collectivité générale.
Le petit-enfant s'adressant à n'importe lequel de ses grands-parents, dira maama (grand-père; grand-mère), ou plus affectivement maamooy. Si dans le discours du petit-enfant il est seulement question de l'un des grands-parents, celui-ci sera taanam, maamam ou maamooyam (mon grand-père; ma grand-mère), suivi de la mention du sexe et de la lignée masculine ou utérine (par exemple taanam debbo jibinnDo neenam — ma grand-mère maternelle), ou bien de l'anthroponyme (maamam Ummu — ma grand-mère Ummu), afin d'abstraire ainsi le porteur de l'ensemble des autres maamiraaBe de son sexe.
Quand le grand-parent parle à son petit-enfant, il dispose de l'anthroponyme usuel que ce dernier a reçu. Si le grand parent parle du descendant, il dit taaniraagelam ou maamiraagelam (mon petit-enfant), en précisant toutefois le sexe (gorel ou dewel) et l'anthroponyme du descendant.
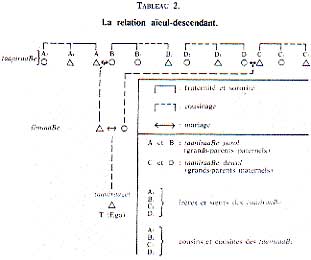
Le tableau 2 n'indique évidemment pas l'ensemble des grands-parents de T (Ego), que l'on récapitulera donc ci-dessus dans l'ordre de parenté décroissante, de moins en moins réelle ou de plus en plus conventionnelle, soit :
b) Par la parenté consanguine et utérine avec les précédents :
A1 — Les frères et sœurs (utérins et consanguins, ou l'un des deux) de A — (mawniraaBe e minyiraaBe worBe e wanndiraaBe rewBe baamum baabam).
A2 — Les cousins et cousines (croisés, consanguins et utérins) de A — (denDiraaBe e BiBBebaaba e remmeraaBe baamurn baabani).
B1 — Les frères et soeurs (utérins et consanguins, où l'un des deux) de B — (wanndiraaBe worBe e mawniraaBe e minyiraaBe rewBe yummum baabam).
B2 — Les cousins et cousines (croisés, consanguins et utérins) de B — (denDiraaBe e BiBBebaaba e remmeraaBe yummum baabam).
C1 — Les frères et sœurs (utérins et consanguins, ou l'un des deux) de C2 — (mawniraaBe e minyiraaBe worBe e wanndiraaBe rewBe baamum neenam).
D1 — Les cousins et cousines (croisés, consanguins et utérins) de C — (denDiraaBe e BiBBebaaba e remmeraaBe baamum neenam).
D2 — Les frères et soeurs (utérins et consanguins, ou l'un des deux) de D — (wanndiraaBe worBe e mawniraaBe e minyiraaBe rewBe yummum neenam).
D2 — Les cousins et cousines (croisés, consanguins et utérins) de D — (denDiraaBe e BiBBebaaba e remmeraaBe yummum neenam).
c) Par l'alliance, nonobstant une parenté antérieure à cette alliance :
— L'époux de B autre que le père A du père de T (joom galle yummum baabam tawa wona baamum baabam)
— L'époux de D autre que le père C de la mère de T — (joom galle yummum neenam tawa wona baamum neenam)
— L'épouse de A autre que la mère B du père de T — (joom suudu baamum baabam tawa wona yummum baabam)
— L'épouse de C autre que la mère D de la mère de T (joom suudu baamum neenam tawa wona yummum neenam)
— Les époux en A1 — (worBe wanndiraaBe rewBe baamum baabam) 6
— Les épouses en A1 — (suddiiBe mawniraaBe e minyiraaBe baamum baabam).
— Le époux en A2 — (worBe denDiraaBe e BiBBebaaba e remmeraaBe baamum baabam)
— Les épouses en A2 — (suddiiBe denDiraaBe e BiBBebaaba e remmeraaBe baamum baabam)
— Les époux en B1 — (worBe mawniraaBe e minyiraaBe yummum baabam)
— Les épouses en B1 — (suddiiBe waniidiraaBe worBe yummum baabam)
— Les époux en B2 — (worBe denDiraaBe e BiBBebaaba e remmeraaBe yummum baabam)
— Les épouses en B2 — (suddiiBe denDiraaBe e BiBBebaaba e remmeraaBe yummum baabam)
— Les époux en C1 — (worBe wanndiraaBe rewBe baamum neenam)
— Les épouses en C1 — (suddiiBe mawniraaBe e minyiraaBe baamum baabam)
— Les époux en C2 — (worBe denDiraaBe e BiBBebaaba e remmeraaBe baamum neenam)
— Les épouses en C2 — (suddiiBe denDiraaBe e BiBBebaaba e remmeraaBe baamum neenam)
— Les époux en D1 — (worBe mawniraaBe e minyiraaBe yummum neenam).
— Les épouses en D1 — (suddiiBe wanndiraaBe worBe yummum neenam).
— Les époux en D2 — (worBe denDiraaBe e BiBBebaaba e remmeraaBe yummum neenam).
— Les épouses en D2 — (suddiffle denDiraaBe e BiBBebaaba e remmeraabe yummum neenam).
— Les époux et épouses des groupes d'âge E, accessoirement.
d) Par l'âge, sauf parenté effective qui est alors privilégiée
E1 — La classe masculine de même âge que A — (fedde worde baamum baabam).
E2 — La classe masculine des aînés de A [7] — (fedde worde dow baamum baabam).
E3 — La classe masculine des cadets de A[7] — (fedde worde les baamum baabam).
E4 — La classe féminine de même âge que A — (fedde rewre baamum baabam).
E5 — La classe féminine des aînées de A — (fedde rewre baamum baabam)
E6 — La classe féminine des cadettes de A — (fedde rewre les baamum baabam).
E7 — La classe masculine de même âge que B — (fedde worde yummum baabam).
E8 — La classe masculine des aînés de B — (fedde worde dow yummum baabam).
E9 — La classe masculine des cadets de B — (fedde worde les yummum baabam).
E10 — La classe féminine de même âge que B — (fedde rewre yummum baabam)
E11 — La classe féminine des aînés de B — (fedde rewre dow yummum baabam)
E12 — La classe féminine des cadettes de B — (fedde rewre les yummum baabam)
E13 — La classe masculine de même âge que C — (fedde worde baamum neenam)
E14 — La classe masculine des aînés de C — (fedde worde dow baamum neenam)
E15 — La classe masculine des cadets de C — (fedde worde les baamum neenam)
E16 — La classe féminine de même âge que C — (fedde rewre baamum neenam)
E17 — La classe féminine des aînées de C — (fedde rewre dow baamum neenam)
E18 — La classe féminine des cadettes de C — (fedde rewre les baamum neenam)
E19 — La classe masculine de même âge que D — (fedde worde yummum neenam)
E20 — La classe masculine des aînés de D — (fedde worde dow yummum neenam)
E21 — La classe masculine des cadets de D — (fedde worde les yummum neenam)
E22 — La classe féminine de même âge que D — (fedde rewre yummum neenam)
E23 — La classe féminine des aînées de D — (fedde rewre dow yummum neenam)
E24 — La classe féminine des cadettes de D — (fedde rewre les yummum neenam)
Les taaniraaBe sont par conséquent en nombre appréciable, mais ce nombre importe probablement moins que les comportements observables entre petits — enfants et grands — parents, dont les relations réciproques sont des relations d'opposition oscillant entre la répulsion et l'hostilité bon enfant, laquelle consiste à échanger des plaisanteries Il va de soi que ces attitudes supposent entre leurs tenants une parenté réelle Si les quatre grands — parents de la première catégorie sont concernés rigoureusement, ceux de la seconde classe participent accessoirement à ces relations avec leurs petits — enfants « consanguins » et « utérins » En ce sens, ces deux derniers groupes C et D se trouveraient donc exclus des relations avec les petits-enfants, mais exclus en apparence seulement, car la parenté conventionnelle peut être sublimée par ceux qu'elle lie, et transformer objectivement leurs comportements.
Cette restriction faite, l'on observe en premier lieu la relation de plaisanteries entre aïeul et descendant, relation qui autorise le premier à formuler des malédictions à l'encontre du second. Tout en cherchant à lui tirer les oreilles, il souhaitera une mort rapide 8 à ce « goinfre, qui dévore tout et ne laisse rien à manger aux autres :
Allah bonni ma yiɗi nyaamde — Allah na waawi maaya Buutanduru! »
Le petit-enfant doit subir cette agression orale sans le moindre signe d'angoisse, sauf à mettre ses oreilles à l'abri, car l'aïeul les lui tordrait sans pitié. Non seulement la riposte est permise au descendant, mais il est encore avéré que les malédictions des grands-parents sont sans effet : « Kuddi taaniraaBe ala ko bonnatta ». L'on est si bien persuadé de cette disposition, que le grand-parent n'hésite nullement à dire de ses petits-enfants qu'ils sont « innombrables comme la terre » (e Be mbay no leydi), alors que le fait de s'exagérer (haawtaade) le nombre de personnes quelconques est considéré comme une manière directe de les condamner à disparition imminente, sinon de les désigner à un sort funeste. C'est pourquoi l'on s'interdit généralement de compter les personnes, et quand on doit le faire il est convenable à l'issue de l'opération de citer une formule bénéfique ayant valeur d'antidote, et pouvant se traduire approximativement par « Dieu accroisse votre nombre 9 ».
Grand-parent et petit-enfant s'opposent en termes de subsistance, mais leur rivalité a probablement un autre sens. Grand-mère et petits-fils étant, en effet, symboliquement épouse et mari (à l'instar de grand-père et petite-fille), il n'est pas abusif de penser que la rivalité objective aïeul-petit-fils, ou grand-mère-petite-fille aurait rapport d'une certaine manière à des couples matrimoniaux apparemment incestueux. Les malédictions du vieillard n'exprimeraient-elles pas en la remaniant la jalousie du mâle à l'endroit d'un concurrent, d'autant plus redoutable qu'il a pour lui la jeunesse ?
Outre cette opposition relative à la parenté à plaisanteries, il en est d'autres qui sont davantage marquées d'hostilité. C'est ainsi qu'il sera courant de prêter à la grand-mère des intentions maléfiques visant ses petits-enfants en bas âge, qui sont nés de sa propre fille : elle chercherait à les « dévorer ». Défense permanente lui en sera faite au moyen d'un collier de perles blanches, que l'on fera porter à l'enfant dès les premiers jours de sa naissance et jusqu'au-delà de son sevrage (ennto) 10. Le blanc étant la couleur déclarée de toute-puissance surnaturelle hostile, le semblable tiendra le semblable à distance, en l'occurrence perles blanches contre sorcellerie de grand-mère.
Pourtant, lorsque leur mère décède prématurément, des suites de couches par exemple, les enfants en bas âge sont généralement confiés aux soins de leur grand-mère (mère de la défunte), de préférence à une sœur de la défunte. Alors, l'on dit que la grand-mère se substituant réellement et définitivement à sa fille, opère un transfert, son hostilité faisant place à la tendresse et à la pitié. Au demeurant, ce décès prématuré et inattendu, apparaissant donc tant soit peu inexplicable, est presque toujours imputé à l'hostilité de la grand-mère qui se serait trompée d'objet.
L'opposition est encore plus franchement marquée entre arrière grand-parent et petit-fils correspondant : la longévité exceptionnelle du premier mettrait le second en danger de mort, car il est entendu que cette longévité n'est possible qu'au prix de la « vie » des jeunes, que l'ancêtre aurait le pouvoir de capter à son profit. C'est bien souvent la mésaventure qui échoit au njaatiraaɗo, quand par exception il survit à beaucoup de ses descendants : il sera directement rendu responsable de sa survie et accusé de sorcellerie. Il est vrai qu'une semblable accusation peut aussi être consécutive au grand âge, et du seul fait de cet âge très avancé, par conséquent indépendamment de toute mortalité dans la famille. Autrement dit, la vieillesse est maléfique d'une certaine manière puisqu'elle est passible d'assimilation avec la sorcellerie.
Entre la génération des grands-parents et celle des petits-enfants il existerait en définitive une « tension », mais c'est une tension très diverse de nature : elle s'exprimera dans des relations à plaisanteries, et dans la concurrence à mobile nutritif ou sexuel. Sinon elle se traduira par la crainte et la méfiance qu'éprouvent les jeunes à l'égard des vieilles personnes, tant l'apparence décharnée et presque fantomatique de celles-ci est saisissante, et combien distincte de l'image offerte habituellement par la majorité des gens de l'entourage. Le vieillard se parle tout le temps à lui-même : avec quel esprit diabolique peut-il donc avoir ce commerce ?
L'on doit pourtant dire des attitudes objectives des aïeuls relativement aux petits-enfants qu'elles sont caractérisées par l'absence d'animosité: « taaniraaɗo ko mbuha — le descendant c'est (bon) comme la moelle » a coutume d'affirmer le grand-parent lorsqu'il exprime la satisfaction d'avoir assez longtemps vécu pour voir naître ses petits-enfants. La relation aïeul-descendant est toujours empreinte de grande tendresse, et d'une indulgence sans limite. Le grand-parent ne lève pour ainsi dire jamais la main sur le plus insupportable de ses petits-enfants, dont il tolère difficilement la correction par quiconque, lui-même se bornant parfois à porter ces kelle taaniraaɗo 11, connues pour faire plus de bruit que de mal. Quant au njaatiraaɗo réputé « dangereux » il est à remarquer que sa tendresse à l'égard de sa descendance croît avec l'éloignement de celle-ci. Le njaatiraaɗo aime son fils moins que son petit-fils, et celui-ci moins que l'arrière-petit-fils. Ceci est d'autant plus ostensible que les quatre générations coexistent exceptionnellement, faisant par conséquent du njaatiraaɗo en même temps un taaniraaɗo et un jinnaaɗo. Le privilège qu'il accorde à son rôle d'arrière-grand père est manifeste, parce que ce rôle s'exerce sans doute à l'endroit des êtres les plus jeunes et les plus proches de lui, par le fait qu'ils sont fort peu sollicités par la vie extra-familiale. En outre, il entre en ligne de compte la secrète fierté du njaatiraaɗo qui, avant de disparaître, aura connu ses BiBBe, taaniraakon et njaatiraakon 12, qui vont perpétuer et accroître effectivement la lignée familiale.
Un couple légalement constitué par les liens du mariage acquiert le droit à l'appellation jinnaaBe le jour où il procrée son premier enfant. Le terme jinnaaBe symbolise donc fondamentalement la relation du couple géniteur avec les enfants qui en sont issus.
Si l'origine mythique de quelques ancêtres par trop lointains est communément admise, il va pourtant de soi que l'existence d'un individu réel n'est jamais conçue autrement qu'en fonction de deux jinnaaBe non moins réels, même dans le cas où l'un d'entre eux serait inconnu. Et lorsque les deux parents également inconnus font de l'individu un être dépourvu ostensiblement de géniteurs (mo ala jinnaaBe), ce n'est pas tant le fait objectif qui retient l'attention que sa conséquence sociale pour la personne concernée : son sort est comparé à celui d'un bloc erratique sans destination précise, parce qu'il est privé du « gouvernail » que constituent les jinnaaBe. 13 ne recevra pas l'éducation qui permet son insertion sociale, et il n'aura pas davantage un garant de sa caste d'origine pour pouvoir fonder un foyer; seule la caste servile lui sera à la rigueur ouverte.
La signification des jinnaaBe déborde assurément le cadre familial. Et si, à l'intérieur de ce cadre tout jinnaaɗo est en droit nanti de responsabilités écrasantes sur un groupe restreint, au niveau de la collectivité générale le jinnaaɗo de sexe masculin sera l'unique locuteur. En effet, lui seul parce que digne de foi peut témoigner, de préférence à la femme, au vieillard, voire à l'adulte non jinnaaɗo. Lui seul doit toujours être consulté et écouté, et toute décision de la collectivité sociale passe par lui, car cette décision est constamment soumise à la délibération souveraine de tous les jinnaaBe mâles.
La dimension sociale du jinnaaɗo est certainement considérable, mais ici l'on s'en tiendra exclusivement à l'aspect familial, pour examiner successivement les deux notions complémentaires de la paternité (baabiraagal) et de la maternité (yummiraagal), qui sont constitutives du jinnaagal primaire.
a) La relation de paternité-filiation (baaba-Biɗɗo)
Comme la catégorie de taaniraaɗo multiple quant au nombre de personnes, la paternité comporte des degrés divers depuis le père biologique jusqu'aux pères simplement classificatoires. Le père physique unique pour chaque être considéré n'est pas pour autant le seul détenteur de la paternité vis-à-vis de son enfant, car il est censé partager ce lien avec tous ses frères (consanguins et utérins), ses cousins consanguins, utérins et croisés : ils sont sans considération d'âge solidairement et au même titre pères des enfants de chacun d'entre eux. N'importe quel enfant toucouleur apprendra très tôt à considérer chaque apparenté mâle de son père à l'égal de ce père, singulièrement les frères siblings (jiiduBe yumma e baaba) de celui-ci. C'est parce que ceux-ci vivent en général dans une concession unique, à moins que son extension numérique ne contraigne la famille à se disperser (ferde), ou que des conflits internes n'entraînent son éclatement (seerde).
En dehors de la famille propre, et pour ce qui concerne ses rapports avec le groupe social, certaines distinctions seront toutefois établies, désignant baaba tigi le « père vrai », et baabiraaBe sawndiiBe 13 ses frères et cousins. Néanmoins, ce sont là des distinctions purement occasionnelles, opérées à peu près uniquement quand par exemple la collectivité locale investit la communauté familiale, pour y effectuer un baptême ou conclure un mariage. Ces distinctions, qui sont plutôt des précisions, n'impliquent pas véritablement différence entre siblings et cousins, relativement à l'enfant de l'un quelconque d'entre eux. Entre le sibling, le demi-frère consanguin et le cousin consanguin du père, d'une part, le demi-frère utérin et le cousin utérin du père, d'autre part, il existerait à la rigueur une nuance. Les trois premiers seront des baabiraaBe stricto sensu avec mention spéciale pour le sibling; tandis que les deux derniers participent un peu moins nettement à la paternité considérée. Au reste, cette nuance est mise en évidence par le régime matrimonial, car une fille est donnée en mariage par consentement du frère sibling de son père, en l'absence duquel intervient le frère consanguin du père, puis le cousin consanguin avant le frère utérin. La lignée paternelle devra être par conséquent intégralement épuisée avant que les utérins aient chance d'obtenir exceptionnellement le pouvoir de décision.
Une autre catégorie est purement classificatoire, parce qu'elle est paternité en vertu de l'âge. Elle intègre conjointement :
Ces trois classes d'âge (pelle) sont généralement constitutives d'une seule génération au sens large, parce que leurs différents membres ont pratiquement grandi ensemble, participé aux mêmes jeux, subi l'initiation par la circoncision 14 à la même période, et partagé hors du village la réclusion consécutive, durant six semaines. En outre, la classe des giJiraaBe du père physique, son fedde autrement dit, a jadis participé en tant que classe constituée au rapt (ndiiftungu) de la mère de l'enfant lors du mariage, puis présidé plus tard au baptême dudit enfant. Autant de rôles qui confèrent à tous les membres de la classe d'âge, relativement au ɓiɗɗo, de solides droits de paternité.
L'enfant s'adressant à son père dira baaba (père !), ou baabooy par attendrissement; quand il parle de ce père celui-ci devient baabam et baaboyam (mon père). Toutefois, ces termes ne seront suivis de l'anthroponyme que s'il y a lieu de distinguer nommément des autres pères le père dont il est question. Dans la perspective inverse, le père appelle l'enfant par son anthroponyme quand il s'adresse à lui; lorsqu'il parle de son enfant le père dit Byam (mon enfant) en précisant son sexe, Byam gorko (mon fils) et Byam debbo (ma fille), ou encore Byam suivi de l'anthroponyme masculin ou féminin. Le père peut également interpeller son enfant au moyen des termes baaba (père !), neene (mère !), kaaw (oncle!) gorgol (tante !), voire deede (frère aîné ! ou sœur aînée !) : c'est alors que l'enfant porte respectivement l'anthroponyme des père, mère, oncle, tante, frère aînée ou sœur aînée de son père.
b) La relation de maternité-filiation (yumma-Biɗɗo)
A la précédente pluralité des « pères » correspond symétriquement celle des « mères » de l'enfant, ou yummiraaBe. Les sœurs et cousines de la mère physique participent avec elle à la relation de maternité réelle à l'endroit de son enfant, tandis que la maternité classificatoire à l'égard de celui-ci incombe à toute la génération féminine de sa mère physique.
Les épreuves initiatiques adaptées au sexe féminin et consacrant la communauté de génération sont, bien entendu, d'une autre nature que celles des hommes. L'excision ou clitoridectomie apparaît comme une règle générale, à laquelle chaque fille du groupe est soumise, au cours de son allaitement. C'est une simple dévirilisation effectuée en son temps. La clitoridectomie n'a donc pas le caractère sacramentel de la circoncision collective et publique, avec ses opérateurs, ses officiants et la retraite des patients ; le symbolisme en est tout à fait identique, cependant, car l'ablation du prépuce ne vise à rien d'autre qu'à déféminiser d'abord, à consacrer la virilité.
L'équivalent féminin de la circoncision masculine ne serait-il pas le tatouage des lèvres et gencives des filles nubiles ? Cette opération s'effectue sous l'oeil attentif des spectateurs, à l'affût du moindre signe de faiblesse pour pouvoir s'en gausser ultérieurement, tandis que les griottes prodiguent des encouragements en célébrant la témérité, par leurs mélopées rythmées au son du bolong; la jeune fille doit subir placidement la souffrance physique que lui administre une opératrice armée de gerbes d'épines acérées, à tremper dans une décoction noire. Moyennant quoi, la patiente aura au bout du compte ce sourire éclatant et irrésistible, fait du contraste entre dents blanches et gencives noires... La finalité du tatouage est sans doute l'accomplissement d'un canon de beauté, mais sûrement l'apprentissage des souffrances corporelles réservées à la femme tout au long de sa carrière d'épouse et de mère : défloration et enfantement. En tout cas l'épreuve du tatouage crée une parenté d'âge au même titre que la circoncision masculine : les jeunes filles tatouées à la même période se considèrent comme sœurs putatives, d'autant qu'elles appartiennent le plus souvent à la même classe d'âge. Désormais, chaque événement survenu chez l'une — particulièrement le don de la vie ou maternité — devient l'affaire du groupe tout entier.
L'enfant dira neene (mère !) ou par cajolerie neenooy, quand il appelle l'une quelconque de ses mères réelles et classificatoires. Il dira neenam (ma mère), en parlant de cette mère dont l'anthroponyme ne devra suivre que pour établir la distinction entre deux yummiraaBe.
La mère utilisera l'anthroponyme habituel de son enfant pour s'adresser à lui ; elle pourra également se trouver dans la situation précédente du père. En tout cas, elle peut toujours dire Byam (mon enfant), et préciser Byam gorko (mon fils) et Byam debbo (ma fille).
c) Attitudes générales de la parenté-filiation (jinnaagal-Binngu)
En ces périodes d'intense labeur champêtre, étalées généralement entre juin et mars, la place publique (dinngiral) n'est plus guère fréquentée que par les deux générations extrêmes des vieillards (nayeeBe) et des tout jeunes enfants (sukaaBe tokosBe), générations liées par leur commune oisiveté et par une même patience: les premiers attendent la mort (gaynuBe), et les seconds tendent vers la vie (ɓe puɗɗaaki).
La collectivité sociale n'ayant plus ou pas encore leur emploi, ces générations apparaissent quelque peu abandonnées à leur sort. Mais, les seconds s'en accommodent fort bien par une activité ludique débordante, et à la grande satisfaction de leurs jinnaaBe, car jouer est considéré comme nécessaire aux enfants (yo sukaaBe pij), à cause probablement de sa valeur éducative, mais surtout en raison de l'occupation ainsi procurée à l'enfant, et qui laisse par conséquent à la mère les bras et le cerveau libres pour vaquer aux tâches domestiques.
Quelles attitudes peuvent exister entre des parents absorbés par le labeur quotidien pour assurer la subsistance du foyer, et leurs enfants occupés à jouer, les uns et les autres étant rarement saisis dans le couple de la parenté-filiation, mais constituant plutôt deux sections distinctes voire opposées, les jinnaaBe et les BiBBe, chacune d'entre elles obéissant encore au clivage des sexes ?
Il est clair que la continuité de la collectivité sociale est assurée par le passage des jinnaaBe aux BiBBe, la seconde génération étant le prolongement naturel de la première ; il correspond donc à ce schéma somme toute universel certaines règles fonctionnelles pour ainsi dire, à savoir les devoirs mutuels des parents à l'égard des enfants. Par exemple, le droit de domination reconnu aux parents, droit d'éduquer, et son corrélatif, le devoir de soumission des enfants, devoir de s'identifier au modèle social de conduite; ou bien l'obligation dévolue aux premiers d'entretenir les seconds. Toutefois, cette dernière obligation apparaîtrait tel un investissement spéculatif (tinaade e Biyum), dont chaque parent attend une certaine rentabilité (nafoore) pour lui-même, dès lors que son enfant devenu grand « prend de la valeur » (barkinnde).
En effet, le parent espère normalement de l'enfant qui a fait son entrée dans la vie sociale — l'homme est plus directement concerné que la femme à cet égard — la prise en charge consécutive à son entretien prolongé. C'est que l'enfant reçoit de ses père et mère, singulièrement, une véritable somme de bienfaits : tout d'abord la vie (nguurndam), mais ensuite tout ce qui est requis (tampere jinnaaBe), autant pour « persévérer dans son être » que pour permettre une socialisation minimale du jeune. En l'espèce, le futur succès social de l'enfant ne sera guère conçu comme la conséquence de son aptitude individuelle, mais toujours entendu comme l'effet normal, sinon la suite fatale pour ainsi dire des bienfaits des parents (so neɗɗo barkini yo yettu jinnaaBemum).
Dès lors, il apparaît que le ɓiɗɗo ne cesse jamais de dépendre étroitement de ses parents, y compris quand lui même a procréé et devient parent à son tour. C'est une dépendance irréversible, dont chaque dominant est un dominé et réciproquement. Ce qui de proche en proche fait déboucher la chaîne ininterrompue des relations jinnaaBe-BiBBe dans les relations sociales, où l'isolement de l'individu est au surplus radicalement exclu.
Il peut advenir que celui qui a réussi sur le plan matériel résiste consciemment au mécanisme de ces relations: probablement grisé par son succès et les facilités de son existence, le voilà qui devient adepte de l'individualisme, et qui choisit ce moyen égoïste pour vivre systématiquement à l'écart de ses parents (Bokaade banndiraaBe mum), afin de n'avoir pas à « partager » son bien telle que la recommandation en est édictée. Semblable attitude du BiDDo à l'égard des jinnaaBe serait dûment réputée immorale, car elle équivaudrait à refuser d'honorer les créances, à refuser d'assumer sa situation de débiteur à l'égard des géniteurs.
Eteindre la dette naturelle contractée auprès des jinnaaBe, c'est avant tout leur rester soumis, mais encore les nourrir et les vêtir selon ses moyens, tout en entretenant de bonnes relations (teddungal) avec leurs alliés et voisins, qui participent également au jinnaagal étendu.
A chacun de ceux-ci, d'autre part, l'on doit immanquablement quelque chose du point de vue social, à savoir prestation matérielle, présence humaine, divertissement, voire salutations, consolations et bénédictions. Par conséquent, il faut dès que la possibilité en est échue restituer à ceux qui ont donné, et prêter à ceux qui rendront demain, restitution et prêt pouvant prendre l'une ou l'autre des nombreuses formes de la solidarité familiale et sociale. En fait, il serait ici question de solidarité cyclique ou échange perpétuel : l'on se doit à ses prédécesseurs par gratitude sans fin, mais l'on se doit également à ses successeurs pour leur prêter (nyamlude moJJere e teddungal), afin de les mettre eux aussi en situation de restituer (yoBde) plus lard ce qu'ils ont reçu.
Peut-être la formule de « parasitisme social » devrait-elle être alors tempérée, eu égard à ce cycle perpétuel et contraignant du donner et recevoir, plutôt du prêter et rendre, qui est le fondement effectif de la communauté des vivants et des morts (lenyol). C'est un cycle où le refus d'insérer sa conduite singulière n'a pas chance d'être motivé sérieusement, mais sera toujours tenu par la collectivité comme la détermination de son auteur à rejeter globalement les normes traditionnelles (woppude aada).
Si la finalité de la progéniture est le repos des parents et leur retraite assurée, en quoi consiste alors le rôle de chacun des deux géniteurs relativement à l'enfant ? Il faudra tout d'abord remarquer que si la puissance paternelle s'étend à l'ensemble de la famille, il apparaît néanmoins une certaine spécialisation des géniteurs quant à l'influence à exercer sur les enfants : généralement les filles dépendent de leur mère, et les garçons de leur père. Et même en cas de divorce il en est encore ainsi, car l'enfant va plutôt avec le parent de son sexe.
La relation père-enfant est cette parenté indiquée soit par le terme duhol (cordon du pantalon), soit par JiiJam (sang), parenté qui est généralement dénuée de douceur, si elle n'est plutôt fermement caractérisée par la dureté.
Le jinnaaDo-gorko ou baaba est symbolisé par la cravache qui administre les corrections corporelles. C'est donc l'éducateur auquel il faut obéir aveuglément et sans délai. L'enfant, en tant que tel, n'étant pas encore doué de raison connaît cependant la vertu de dressage de cette cravache (loosol) mieux qu'il ne soupçonne l'existence de Dieu, autrement dit seule la correction physique est opérante au stade de l'enfant, et nulle leçon de morale (cukolel annda Allah, anndi ko loosol).
C'est probablement dans l'esprit de l'enfant cette image physique et mentale du père-justicier, qui vaut au baaba ce prestige mitigé de crainte et d'admiration et qui ne s'effacera plus. Devenu adulte, l'homme dont l'honnêteté ou la bonne foi est révoquée en doute confondra publiquement ses détracteurs, en jurant sur Dieu (e barke Allah) ou sur son père (e wonki baabam — par la vie de mon père). Il s'ensuit donc que le père est l'être humain le plus honoré.
Le dressage a pour visée sociale de tremper le caractère de l'enfant, pour le préparer aux situations les plus difficiles de son existence d'adolescent puis d'adulte. Partageant par exemple le repas de son père ou celui d'une quelconque personne, l'enfant se verra appliquer sans pitié la dure norme sociale qui lui refuse le droit à la viande, laquelle est réservée aux seuls adultes (cukolel teew mum ina yeeso). L'enfant qui a sûrement besoin du développement physique de son corps devra en somme attendre normalement pour cela de savoir gagner sa vie (waawannde hoore mum), d'être donc devenu adulte.
En tout état de cause, passé un certain temps où le père joue avec l'enfant encore au stade de nourrisson, celui-ci en grandissant voit progressivement s'estomper la familiarité avec son géniteur, qui est par ailleurs absent de la maison la moitié du temps pour assurer la subsistance quotidienne. Quand le père est au foyer il se repose ou reçoit ses giJiraaBe, et l'enfant sait à son corps défendant combien il est inconvenant de l'importuner. L'absence de familiarité entre père et enfant, la crainte inspirée normalement à celui-ci par celui-là, telle est l'atmosphère courante. Au contraire, la familiarité et l'absence de crainte seront interprétées par l'entourage comme des signes de faiblesse du père, sinon sa volonté délibérée d'éduquer ses enfants hors des normes requises.
Toutefois, qu'il y ait familiarité ou absence de cette familiarité entre baaba et BiDDo, à partir de sa dixième année et parfois même avant cet âge le fils sera requis par son père, pour l'aider dans le labeur quotidien et apprendre ainsi, progressivement, le métier ou la condition traditionnelle des ancêtres, l'agriculture universelle (ndema), la pêche (awo), la forge (mbayla), ou toute autre activité spécialisée. Néanmoins, l'enfant aura au préalable acquis quelques rudiments de versets koraniques, afin de pouvoir pratiquer au minimum sa religion musulmane atavique. L'apprentissage prolongé du Koran incombe aux seuls garçons des castes libres, plus précisément au petit tooroodo, quelquefois au jaawanDo, aux ceDDo et cubballo plus rarement. Tandis que pour les garçons des castes professionnelles ou serviles et les filles de toutes castes, généralement la collectivité sociale estime que leur passage à l'école koranique peut être de courte durée, parce que ceux-là ont un métier à apprendre, et celles-ci doivent être préparées à leur destination conjugale.
La relation mère-enfant sera au contraire dominée par la tendresse, et ce n'est pas hasard si le terme ennDam (de enndu : sein) signifie initialement parenté du lait ou parenté utérine, son sens actuel étant relatif à toute parenté effective, qu'elle soit utérine ou consanguine; ennDam figure en outre l'amour altruiste du prochain, tandis que giDgol (pl. gilli) est signe de l'attrait entre personnes de sexe opposé.
La mère gardienne du foyer est en tout cas aux petits soins pour l'enfant. De notoriété sociale, l'éducation maternelle est très libérale voire inexistante (yumma nehata BiDDo, bonnat). L'on peut s'en rendre compte dès que l'enfant commence à marcher, donc à toucher à tout : la journée durant ce sont mises en garde (hartare) continue : ngel haamni ! « Dieu que cet enfant est impossible ! ». Mais le BiDDo n'a cure de cette agitation maternelle rarement suivie de coups, même quand elle menace : yeed ! mi fyete de : « Reste tranquille sinon je vais te frapper! ». La mère se résout très exceptionnellement à cette extrémité, sous réserve des tempéraments et sauf colère violente, qui sera d'ailleurs aussitôt regrettée puisque les consolations suivent immédiatement. Plus souvent au contraire la mère jaillit pour ainsi dire de la maison, dès qu'elle entend les cris de son enfant à nuls autres similaires : elle est prête à venger l'injustice car il ne saurait en être autrement, son rejeton ne pouvant jamais avoir tort (Holi tonyDoma, fiima !). Poursuivi par la vengeance d'un camarade ou d'une grande personne, l'enfant se précipite dans la case maternelle — subitement blessé ou pris de douleur l'homme mûr invoque également sa mère, haa neenam ! — pour demander protection (moolaade). Le poursuivant doit renoncer à sa vengeance, la victime désormais sacrée étant à l'ombre protectrice de sa mère, qui connaît par ailleurs l'art et la manière pour calmer l'adversaire de son enfant, en plaidant l'inconsciente culpabilité de ce dernier (yarlo ! ko cukolel, annda ko watta) ;
Même la correction qu'inflige le père pour éduquer l'enfant est fort mal vue de la mère, s'il est vrai qu'elle n'est habilitée à aucun titre pour intervenir dans une confrontation entre géniteur et héritier. La mère dispose cependant des ressources de la ruse, pour faire cesser la correction : elle implore pardon pour son enfant en assimilant le petit corps martyrisé à celui de Dieu (Banndu Allah !), qui est naturellement sacré et intouchable. Le frappeur doit en principe mettre immédiatement un terme à la correction, sous peine de lapider consciemment Dieu. Mais la colère du père peut tout aussi bien se retourner contre la mère-interventionniste, laquelle est doublement fautive, par son intolérable immixtion et par sa prétention à invoquer Dieu...
Le rôle de protection maternelle sur l'enfant ne s'entend évidemment pas sans la fonction nourricière: non seulement le moindre cri de bébé signifie faim et requiert le sein, mais plus tard l'enfant apparaîtra toujours trop maigre (omo fooJi) aux yeux de sa mère. Et si besoin s'en fait vraiment sentir, la mère n'aura jamais scrupule à demander aux voisins plus chanceux et incapables de refuser leur secours, un peu de nourriture pour le BiDDo affamé.
Tels sont vraisemblablement certains des motifs qui résolvent l'enfant d'hier devenu adolescent, voire adulte, à se confier plus volontiers à sa mère, et à la charger également du soin de porter éventuellement une confidence à la connaissance du père.
Il arrive aussi que la symbiose mère-fils soit étroite au point que l'image du père dans l'esprit du fils en apparaisse gravement lésée sinon totalement éclipsée. Mais semblable situation est susceptible de redressement, quand la mère s'entend bien avec son époux pour jouer ce rôle délicat de trait d'union (masloowo) entre les générations du père et du fils, liquidant ainsi combien de conflits internes.
La relation mère-fille 15, d'autre part, ne manque pas de frapper par son caractère monolithique. Toute son existence qui précède son mariage, est pour la jeune fille modelée par sa mère qu'elle aide dans les occupations domestiques, afin d'assimiler correctement le rôle qui l'attend. C'est surtout à la mère sinon à elle seule qu'incombe la responsabilité essentielle de faire de la fille une future épouse convenable. De sorte que si celle-là est socialement appréciée, celle-ci sera fiancée le jour même de sa naissance si ce n'est bien avant 16, tant la conviction est ancrée que la seconde vaudra ce que vaut la première, singulièrement du point de vue caractériel et courage au travail. Au reste, il est de coutume d'imputer à la mère tout succès ou au contraire tout échec matrimonial de sa fille. Car si l'homme détient le pouvoir exclusif de donner une femme à un autre homme — le consentement du père ou de son substitut de sexe masculin étant une condition nécessaire et suffisante — en revanche, il dépend de la mère que l'union de sa fille soit durable ou éphémère. La mère exhortera sa fille à soumission, ou au contraire elle mettra rapidement un terme au ménage, quand décidément son gendre ne lui plaît pas. La sagesse populaire exprime cette croyance en la toute-puissance maternelle sur le ménage : « Aussi longtemps que vit sa belle-mère le gendre sait seulement qu'il est marié, mais il n'est pas encore vraiment sûr d'avoir définitivement acquis une femme. »
Outre les père et mère des enfants, la relation de parenté-filiation jinnaaBe-BiBBe inclut d'autres individus. Dans la mesure où les frères et les cousins du père ont part à sa paternité, leur qualité de jinnaaBe worBe est indubitable pour l'enfant, comme sont jinnaaBe rewBe les sœurs et les cousines de sa mère. Mais ces deux catégories, identifiables respectivement au père et à la mère, ne constituent à la rigueur que jinnaaBe de prolongement, leurs relations à l'enfant s'exprimant en tout état de cause par l'un ou l'autre des deux modes déjà analysés, baabiraagal et yummiraagal.
Il en va quelque peu différemment, en ce qui concerne la sœur du père et le frère de la mère. Sans doute, en raison de leur lien de parenté avec chacun des géniteurs des enfants, et clos rôles leur incombant à l'égard de ces derniers, il est difficile d'exclure le frère de la mère et la soeur du père des jinnaaBe. S'il en est ainsi, ne convient-il pas de se conformer à l'esprit du système de parenté, en les rangeant simplement au nombre des jinnaaBe, au lieu d'en traiter à part de ceux-ci ? La raison de ce dernier choix, qui n'est qu'une entorse apparente audit système, est la suivante : davantage que les rôles sociaux y afférant jinnaaBe implique rapport de parenté-filiation. Ce qui n'est pas le cas du frère de la mère et de la sœur du père, parce qu'ils ressortissent respectivement à la consanguinité et à la parenté utérine. Il est donc normal de traiter du frère de la mère et de la sœur du père à la rubrique dont ils relèvent, à la fois en conformité avec les normes habituelles de la parenté et sans aucun préjudice pour les rôles de jinnaaBe que le système toucouleur leur attribue. L'on conviendra d'ailleurs d'utiliser jinnaaBe secondaires (sawndiiBe) pour désigner en même temps la sœur du père et le frère de la mère, que l'on va maintenant situer successivement en restituant à chacun son terme figuratif spécifique, à savoir gorgol et kaaw.
a) La relation tante-enfant (gorgol-BiDDo)
La première notation qui s'impose à ce stade du système de parenté toucouleur, est que la femme ne peut jamais avoir de neveux, mais exclusivement des enfants. En effet, la femme est directement une mère physique, ou bien elle est indirectement une mère classificatoire par la médiation de sa sœur. Et si au lieu des enfants de sa sœur il s'agit de ceux de son frère, la femme n'est plus alors considérée comme mère classificatoire, sans que pour autant elle doive cesser de voir en ces derniers enfants de simples BiBBe et nullement des neveux. A cet égard, il est significatif que le fait d'attribuer des neveux à une femme déclenche immédiatement les rires, parce qu'il s'agit d'un grave contresens (fuujo) dans la conception toucouleur. Par conséquent, selon cette conception commune qui estime que toute parenté avec le père engendre essentiellement paternité à l'endroit de l'enfant, la sœur du père sera considérée autrement qu'une tante. Au demeurant, il n'y aurait eu tante que si d'abord le frère ou cousin du père avait été oncle, au lieu d'être baaba. Ce terme baaba ne pouvant valablement s'appliquer à une personne du sexe féminin, la distinction aurait été opérée au moyen de gorgol, signifiant étymologiquement « sœur du père » en même temps qu'il traduit cette véritable incertitude qui plane sur la personne concernée. Car la gorgol n'est ni la tante des enfants de son frère, ceux-ci étant appelés ses enfants, ni leur « père », son sexe s'y opposant formellement, ni leur mère, en dépit de son sexe, mais surtout à cause de sa consanguinité avec leur père. Il faut délibérément opter pour « père de sexe féminin », puisque telle est la valeur subjective, restant toutefois entendu que gorgol a subi des glissements de sens, et exprime des natures de parenté différentes de l'étymologique « sœur du père ».
La sœur du père B est la seule vraie gorgol G, parce qu'elle est la plus proche de lui dans l'ordre de la parenté. Toute sœur du père répond à cette définition, qu'elle soit utérine et consanguine du père, ou l'un des deux seulement. Est également gorgol vraie, mais à un moindre degré que la sœur du père, toute cousine du père, soit G1, G2 et G3.
La seconde catégorie des gorgolaaBe par alliance (non représentée) est triplement composée : d'une part, dans un ménage polygame par chacune des femmes du père, la mère exceptée; d'autre part, pour toute épouse du frère ou demi-frère du père; enfin, par la femme du frère ou demi-frère de la mère, à savoir la femme de l'oncle 17.
Les soeurs et cousines des gorgolaaBe par alliance ont droit au titre de gorgol vis-à-vis de l'enfant de référence, à moins d'une parenté antérieure à laquelle s'ajoute au demeurant la qualité acquise par l'alliance, qui n'est pas prééminente toutefois.
La génération féminine du père fournit les gorgolaaBe purement conventionnelles, à l'instar des soeurs d'âge de la vraie gorgol. Mais la camaraderie d'âge jouant pleinement à l'intérieur du même sexe, et secondairement d'un sexe à l'autre, en conséquence la génération féminine de G sera davantage que celle du père B admise au titre de gorgol.
Généralement, l'enfant nomme sa tante gorgol (tante !), ou gogooy pour manifester une plus grande affection, sinon goggo qui est un diminutif plus affectueux encore. Lorsqu'il est seulement question de cette tante, l'enfant dira gorgolam (ma tante) ou gogooyam.
Quant à la gorgolaajo relativement à l'enfant, trois cas se présentent. La gorgolaajo sœur ou cousine du père dira Byam (mon enfant), et Bi-banndam-gorko (enfant de mon frère). La gorgolaajo co-épouse de la mère de l'enfant a le choix entre Bi-joom-gallam (enfant de mon mari), en considération du père de l'enfant, et Bi-nawlam (enfant de ma co-épouse), en tenant compte de la mère. Enfin, il y aura la gorgolaajo femme de l'oncle : en réalité ce dernier cas mérite attention, car la femme de l'oncle est la seule à n'être pas gorgol en considération du père, mais eu égard à la mère dont elle est la belle-sœur. A cause de quoi probablement elle est souvent appelée « tante parallèle », en sa qualité particulière d'épouse de l'oncle. De là procède également le terme en usage dans le Damga où, au lieu d'appeler la femme de l'oncle du nom de gorgol, l'on utilise un terme wolof, yumpaany. Or, ce palliatif au terme autochtone absent s'applique précisément dans la langue d'origine à la femme de l'oncle; il resterait toutefois à expliquer l'itinéraire qui le fait aboutir dans le Damga uniquement, et non pas dans une autre région du pays toucouleur.
En tout état de cause, la relation yumpaany-BiDDo est passablement différente de la relation normale gorgol-BiDDo ; la femme de l'oncle exprime bien ce lien plus lâche, en disant « les neveux de mon mari — baaDiraaBe joom-gallam ». Car la femme de l'oncle ne participe pour ainsi dire pas au rôle dévolu à toutes les autres gorgolaaBe, singulièrement aux sœur et cousine du père. Elle a d'abord, un rôle de marraine attitrée de tous les enfants de son frère, enfants que la gorgol reçoit sur ses genoux le jour du baptême, pour raser entièrement le crâne du nouveau-né, rite préalable à l'imposition du nom par le marabout. Ensuite, il incombe à la gorgol ce rôle d'éducation qui lui fait obligation de seconder son frère, voire de se substituer à lui quand il est absent, pour exercer à l'endroit des enfants dudit frère. Lorsqu'un bambin la fermeté a mal agi ou se prépare à enfreindre une interdiction, il suffira soit à la à sa mère de le menacer de tout raconter, soit au père, gorgol, pour l'amener à contrition. On peut avancer qu'à l'égard des enfants de son frère la gorgol perd la féminité, synonyme d'irresponsabilité sociale, pour se voir attribuer une parcelle de cette masculinité, qui gouverne sans partage la communauté à tous ses niveaux, masculinité symbolisée par le pantalon en tant qu'il est l'attribut unique de l'autorité sociale (tuuba ko ngoota). Cette responsabilité par procuration reconnue à la gorgol parce qu'elle est la sœur du père, c'est corrélativement le droit pour elle de donner son avis chaque fois que la question matrimoniale se pose relativement à ses filleuls, particulièrement de sexe féminin. Certes, la voix de la gorgol n'est jamais prépondérante sur celle de son frère géniteur et vrai responsable, mais une certaine latitude est quand même reconnue à ce « père de sexe féminin », pour l'élaboration de la réponse (rejet ou acquiescement) à la demande en mariage visant telle fille de la maison. De toute manière, puisqu'elle est femme la gorgol n'a pas capacité pour donner en mariage: le consentement, qui pourrait se passer d'elle quand sa propre fille est concernée, requiert en revanche son accord ou son avis, lorsque la fille de son frère est l'objet de la demande.
b) La relation avunculaire (kaaw-baaDiraaDo)
Toute sœur ou assimilée de la mère physique, que ce soit parenté utérine comme consanguine, est une mère classificatoire. Cette relation de maternité classificatoire se mue en avunculat, lorsque la personne apparentée à la mère est de sexe masculin. Autrement dit, dans le système toucouleur l'homme seul aura des neveux, et exclusivement quand il est le frère de la mère ou bien lorsqu'il est assimilable audit frère.
Comme tous les jinnaaBe précédents, les kaawiraaBe se rangeront sous trois rubriques, à savoir celles de l'oncle effectif, de l'oncle par alliance, et de l'oncle conventionnel.
K est l'oncle réel parce qu'il est le frère ou le demi-frère de la mère, tandis qu'à l'échelon immédiatement inférieur se situent ses cousins (K1, K2, K3) utérins, consanguins et croisés.
Les kaawiraaBe par alliance seront l'époux de la mère autre que le père 18, l'époux de toute sœur de la mère, les frères et cousins de ces époux. Encore, par la médiation de l'alliance mais au degré secondaire, s'inscrivent respectivement l'époux de la sœur du père, tous les frères et cousins de cet époux, enfin, les frères et cousins de la co-épouse de la mère.
Hors de toute parenté assignable il y aura les kaawiraaBe conventionnels et symboliques. Les premiers sont, d'une part, représentés par le groupe masculin des giJiraaBe, mawniraaBe et minyiraaBe de K, et par la même trinité masculine, d'autre part, mais relative à la mère sœur de K. Quant aux seconds — les kaawiraaBe symboliques — ce sont par rapport à leurs esclaves tous les « propriétaires » de sexe masculin. Car pour exprimer sa dépendance à son maître, l'esclave doit lui appliquer selon le sexe et l'âge l'un des termes de désignation des jinnaaBe. C'est que l'esclave se définit et se situe non pas du point de vue de l'appartenance familiale, autrement dit par ses géniteurs, mais uniquement du point de vue social, c'est-à-dire par sa dépendance vis-à-vis d'un maître (kaliifa-kaliifam). Il ne lui est jamais demandé « qui est ton père », ou « quelle est ta mère » (mo jibinn ma ?), mais plus couramment il sera identifié par l'intermédiaire de son maître (mo halfuma ? quel est ton maître ?). Que son maître se substitue au jinnaaDo de l'esclave, voilà sans doute l'omnipotence des jinnaaBe sur leur descendance, si le rapport de servilité comme la relation de filiation peuvent s'exprimer par un seul terme.
Le neveu appellera son oncle (frère ou cousin de sa mère) kaaw, (oncle!), ou plus affectivement kaawooy ; parlant de lui il dira soit kaawam (mon oncle), soit kaawooyam. En ce qui concerne l'oncle par alliance, il semble que les nuances affectives fassent défaut, le seul terme de désignation kaaw étant usité, comme pour les oncles conventionnel et symbolique.
L'oncle dira Bi-banndam debbo (enfant de ma sœur), ou bien pour être plus précis baaDam debbo (ma nièce), et baaDam gorko (mon neveu).
La vraie relation oncle-neveu, de K à l'enfant de sa soeur, est hautement valorisée par les Toucouleur. Elle est supérieure pourrait-on dire à la relation mère-enfant, dont elle est pourtant originaire et qu'elle prolonge dans l'ordre masculin. Et si la sœur du père est réputée « père de sexe féminin », davantage encore le frère de la mère pourrait être défini objectivement « mère de sexe masculin », à en croire l'allégorie du rôle de l'oncle dans l'au-delà :
« Le jour du jugement dernier, alors que la terre et les cieux auront cédé au néant irréversible et le souvenir de leurs relations terrestres perdu sans rémission par les humains, chacun devra individuellement répondre devant Dieu de la totalité de ses actes ici-bas. Père et mère se récuseront comme témoins de leur enfant que son oncle seul reconnaîtra immédiatement comme sien. L'oncle se dressera pour plaider la cause de l'enfant de sa sœur; le caractère chaleureux et inspiré de son argumentation parviendra à incliner le Tribunal Suprême à l'indulgence pour sauver l'accusé des enfers, et l'introduire sinon au paradis alors au purgatoire. « ko kaawiraaDo naanata aljanna 19. »
Selon ce mythe édifiant — postulat d'une justice transcendante disposée au pardon — l'oncle détient le pouvoir sans précédent d'« enfanter » une seconde fois l'enfant de sa sœur, en le ressuscitant pour l'éternité.
Précisément, le retour à l'expérience courante montre l'intérêt particulier voué par l'oncle aux neveux, qui sont préférentiellement destinés à devenir ses gendres et brus. Ce n'est pas l'oncle qui gronde le neveu, ou lui administre la correction. Bien sûr, son statut de simple jinnaaDo matrilatéral n'autorise pas expressément des conduites ressortissant davantage à la compétence paternelle, mais ne l'interdit pas catégoriquement, car en tant qu'il est un homme l'oncle est donc dépositaire de l'autorité au sein de la famille. En tout cas, il choisit habituellement le rôle plus attractif de la bonté et de la complaisance, rôle bien connu des neveux qui ne se font jamais faute d'en profiter. L'oncle dispense les gâteries, et demeure un refuge permanent et sûr contre la sévérité du père ou de la mère et leur punition imminente, voire plus tard contre la tyrannie domestique d'un mari — probablement fils ou gendre trop conscient de ses droits. Ici et là le nécessaire sera toujours fait ou tenté par l'oncle, pour aplanir les difficultés.
Que partant de ce rôle, la conscience populaire ait forgé le mythe du pouvoir extra-terrestre de l'oncle, la conséquence est satisfaisante pour l'esprit, à moins que le rôle actuel soit plutôt une simple anticipation du futur... On peut en tout cas hasarder une explication au fait que ledit mythe soit moins souvent exposé par le marabout que par les femmes. Il ne s'agit peut-être pas de la plus grande crédulité de celles-ci, mais de leur situation par rapport aux hommes qui les dominent leur vie durant. Notoirement le père éduque sans douceur, après quoi il donne (rokka) définitivement sa fille à un autre homme : du géniteur à l'époux il n'y a pas atténuation mais accroissement de la dépendance. Alors que le frère est le seul mâle, qui ne se situe pas relativement à sa sœur sur le mode de la supériorité et de la propriété absolues : d'abord frère de la mère, il bénéficie du préjugé favorable que lui accorde celle-ci, et qui inculquera plus tard son préjugé à ses propres enfants. C'est le même homme qui est visé par le même culte de la femme pour son frère, culte transmis par les soins de sa principale adepte à la génération suivante. Laquelle va l'assumer d'autant plus durablement que l'oncle — « divinité » répond tangiblement à ses adorateurs par son soutien indéfectible. Voilà probablement l'une des significations de la primauté de l'oncle — frère de la mère, et la raison pour laquelle la femme, principale bénéficiaire, en perpétue l'idée à travers les générations successives. C'est que la domination et la violence masculines, incarnées par la dualité père-époux, sont tempérées par cette trinité de la tendresse, que constituent pour la femme le frère de sa mère, son propre frère et son fils, tous oncles effectifs ou virtuels, et protecteurs déclarés contre le pouvoir absolu des mâles.
La relation de consanguinité simple (duhol, JiiJam) tel est le mode d'apparentement des BiBBe (enfants) quand ils sont issus de baaba gooto (père unique). Ces mêmes enfants pourront être, soit des utérins (kosam, ennDam) parce que nés de la même mère (yumma gooto), soit alors des consanguins et utérins (jiiduBe yumma e baaba).
La génération des BiBBe va maintenant être considérée, tandis que les relations générales entre consanguins et entre utérins interviendront plus distinctivement au chapitre du cousinage.
a) Primogéniture et rang de naissance
Quel que soit son sexe, le premier enfant est communément appelé afo ou dikkuru, chacun des termes signifiant indifféremment aîné de la progéniture du couple considéré. Dans un ménage monogame il ne peut y avoir qu'un seul dikkuru, et le ménage polygame en comptera autant que le nombre de femmes, en quelque sorte lors de la première délivrance de chacune d'elles. Toutefois, dans le cas de polygamie c'est le premier enfant de la première épouse chronologique 20 qui sera tenu pour l'aîné absolu de tous les autres enfants. L'aîné de sexe masculin est davantage prisé, car c'est un futur producteur destiné à prendre la relève de son père, pour perpétuer la famille dont il ne peut normalement sortir. Tandis qu'à l'inverse, la fille est vouée par le mariage à quitter le foyer où elle est née, la femme étant toujours un bien qui attend d'être approprié (debbo ko jawdi, annda Do yantata).
Mais si toute épouse considérée — dans la mono comme dans la polygamie, et sauf premier accouchement gémellaire — n'a pour dikkuru que son premier enfant, indépendamment du sexe de ce dernier, en revanche elle aura deux afo si sa fécondité ne tarit pas : d'une part, ce dikkuru-là, que nous conviendrons de sexe masculin (afo gorko), d'autre part, la première fille puînée (afo debbo) sans considération de rang dans l'ordre de naissance des enfants de cette même mère. En conséquence, le premier enfant du sexe opposé à celui du dikkuru est conventionnellement un second afo.
Afo et dikkuru ne sont pas à proprement parler des anthroponymes, encore que le prénom féminin Dikko semble procéder du second terme. Toutefois, Dikko est davantage formulation du souhait : « Puisses-tu (vivre et) enfanter ! », qu'il n'indique la position d'aînée pour la fille ainsi nommée. Telle est d'ailleurs la destination de maints anthroponymes, qui expriment la volonté sociale d'exorciser le sort. JooDo (Demeure !) et Sikkaaka (Inespéré) viseraient à mettre un terme à la mortinatalité prolongée et désespérante, alors que Sadak (Aumône), GanyaaDo (Haï) et Woppa (Abandonné) seraient encore plus aptes à accorder longévité à l'enfant. Il s'agit précisément d'une ruse, consistant à faire comme si l'on ne souhaitait aucunement la vie de l'enfant. En conséquence, paraissant abonder dans le propre sens des puissances surnaturelles hostiles à la vie de l'enfant — traiter le semblable par le semblable — l'on contrarie effectivement lesdites puissances. Dès que celles-ci n'apercevraient plus en leurs adversaires humains que des êtres gagnés à leur cause, il y aurait mutation immédiate de leur hostilité. Non seulement les puissances surnaturelles désarmeraient complètement en cessant de s'en prendre à la vie des enfants, mais elles deviendraient même protectrices. Car entre le surnaturel et l'humain la seule opposition inégalitaire est de rigueur : l'identité de vues rabaisserait le premier.
Le prénom de l'aîné des enfants est variable selon les provinces du Fouta, mais dans le Damga et le Ngenaar (département de Matam) le premier enfant de sexe féminin était Sira, et Hammadi celui de sexe masculin. Aujourd'hui, l'on aurait tendance dans certaines familles à préférer respectivement Raki (diminutif usuel de Rakya, qui donne également Rokaya ou Rugya), et Mammadu, abandonnant à la caste servile l'usage exclusif de Sira et Hammadi, lesquels demeurent cependant en honneur dans l'ethnie peul de stricte tradition.
Que ce soit Sira ou Raki, Hammadi ou Mammadu, chaque enfant recevra au demeurant deux prénoms distincts : celui choisi par le père et qui donne lieu à imposition publique 21 Par le marabout, et celui proposé hors cérémonie par la mère agissant de concert avec ses sœurs, cousines et camarades d'âge. Ces deux choix entrent alors en compétition régulière, et c'est l'usage social qui doit finalement décider lequel des anthroponymes l'emporte et efface l'autre.
Par ailleurs, quel que soit le sexe de la personne, son prénom usuel sera constamment associé à celui du père ou à celui de la mère, pour marquer la filiation. Ainsi donc, Hammadi Malal et Hammadi Kumba, membres du même groupe d'âge, appartenant à une caste commune et habitant le même quartier, ne seront pas confondus : la filiation du premier est relative au père (Malal), celle du second à la mère (Kumba), et il s'agit de deux familles distinctes. Leurs patronymes pourraient certes établir la distinction entre Hammadi Malal (Taraore) et Hammadi Kumba (Sy), mais le nom de famille (yettoode) 22 intervient à peu près exclusivement pour échanger des salutations, en dehors desquelles le patronyme semblera à peine indispensable, qu'il s'agisse de la carte d'identité, de la quittance d'impôt comme du certificat d'employeur. En règle générale, à quelque sexe qu'elle appartienne la personne sera invariablement connue de tout le village sous son seul prénom (simple ou double), accolé couramment à celui du père (Amadu-Tijaan Demba; Ummu Amadu), ou plus rarement à celui de la mère (Demba Sala; Kumba Ummu).
Les prénoms des enfants puînés sont davantage invariables que ceux des aînés, de sorte que le rang de naissance pourrait être indiqué au moyen du seul anthroponyme. Ainsi, quand tous les enfants d'un couple se trouvent être de sexe masculin, ils seront nommés dans l'ordre respectif de leur naissance :
Avant de clore ce paragraphe, l'on fera quelques notations au sujet de certaines catégories d'enfants qui ne sont pas sans présenter des particularités sociales.
Tout d'abord le Bi-haram ou enfant naturel: il est socialement caractérisé par une absence de statut; en tant qu'issu du « péché », c'est un être perpétuellement condamné à une existence marginale, ne pouvant par exemple épouser la personne de son choix, ni accéder par ailleurs à la succession de son père, quand bien même celui-ci aurait assumé sa responsabilité. D'autre part, s'il arrive que les deux géniteurs « régularisent » la situation en se mariant après coup, le lien matrimonial n'a pas d'effet rétroactif sur le statut de l'enfant naturel. A la rigueur, le mariage peut « tempérer » le statut de l'enfant: telle est du moins la codification formelle de l'Islam, dont procède au demeurant le terme (Bi) haram, plus usuel mais tout aussi péjoratif que son équivalent laïque deedaaDo, signifiant littéralement « génération spontanée », ou encore « celui dont la mère légère et sans mari s'est trouvée enceinte par rencontre ». Bi-haram et deedaaDo sont également injurieux, d'autre part, et tellement grossiers 27 que celui qui en use est presque toujours violemment en colère. C'est pourquoi l'individu qui y correspond effectivement subira avec ses parents, et plus particulièrement sa mère, un calvaire permanent dans le groupe social.
Il en va différemment du Bi-taara singularisé par l'origine servile de sa mère, laquelle est cependant très légalement la concubine du père, qui est un homme libre. La taara est presque toujours épousée dans un cérémonial fort simplifié, postérieurement à d'autres femmes libres auxquelles elle vient s'adjoindre, mais sans être tout à fait leur égale. Ce qui manifeste chez le mari polygame soit la richesse ou la puissance, soit le mimétisme respectueux à l'égard d'un exemple religieux que le prophète Mahomet aurait introduit, et dont le Shaykh Umar Taal fut un célèbre imitateur toucouleur. Le fait est encore commémoré aujourd'hui par n'importe quelle guitare (hoddu) bambaaDo, sous le thème musical de Makki Taara.
Ce qui subsiste de la servilité est considéré comme pratiquement effacé lorsque la taara donne naissance à un enfant avec son mari, libre, effacé par cette naissance même. Les enfants de taara par le fait de la filiation patrilinéaire relèvent de toute manière de la seule caste libre de leur père. Mais, ils n'en demeurent pas moins « marqués » apparemment, même si en matière matrimoniale ou successorale ils sont rigoureusement à égalité avec leurs demi-frères et sœurs ; jouissant complètement du statut de leur père, ils sont tout de même en « situation » pour ainsi dire, eu égard à leur lignée maternelle composée d'esclaves stricto sensu.
L'ambiguïté, précisément, c'est que l'un de ces esclaves peut par exemple « appartenir » au sens concret du mot à celui qui dans l'ordre de la parenté utérine est son neveu. En l'espèce, l'esclave — traditionnellement parlant — peut avoir pour maître le fils de sa propre sœur taara, un maître dont il est le jinnaaDo (kaaw) et qui dépend de lui par conséquent. Y a-t-il finalement dépendance réciproque, ou bien abolition du lien de parenté et maintien du lien de propriété ? Le second terme de l'alternative semble plus courant, l'esclave se voyant alors marquer les égards particuliers que lui confère sa qualité de parent de la taara.
Le tableau 7 est la représentation d'un ménage polygame (nawliigu) réel observé en 1963, et comprenant l'ensemble des enfants qui en sont issus. Trois épouses seulement étaient effectivement présentes, la femme B ayant été répudiée depuis quatorze ans, tandis que la femme A divorcée d'avec P pendant onze années avait finalement réintégré son ménage. C'est sa longue absence qui explique l'écart d'âge entre les enfants 3 et 5, soit treize ans entre frère et sœur successifs d'une mère commune.
Un seul dikkuru apparaît ici en dépit du nombre d'épouses: c'est le no 1, dont la mère A avait été épousée jeune fille. C'est également entrée dans ce ménage étant jeune fille mais son dikkuru n'a pas vécu. Quant aux femmes B et D elles ont donné leurs dikkuru à des foyers précédents. De ce fait, elles se trouvent encore exclues pour le comptage des afo. Ceux-ci sont au nombre de trois, à savoir les enfants 1, 2 et 6 qui sont respectivement premier garçon de A, première fille de A et premier garçon de C. Seul 1 est afo réel, tandis que 2 et 6 sont afBe conventionnels parce que chacun d'eux est le premier représentant de son sexe pour la mère considérée. Relevons au passage l'écart d'âge entre 2 et 6 — dix-huit ans et demi — écart qui a permis à 2 de donner deux neveux, dont l'aîné a sensiblement le même âge que son oncle 6 tandis qu'il est plus âgé que ses autres oncles 8, 9 et 10.
Une seule kodda réelle est à considérer, d'autre part, en la fillette 7, sa mère semblant avoir atteint la ménopause. Kodda de sa mère 7 est cependant plus âgée que 8, 9, 10 et 11. Relativement à l'ensemble du ménage elle devient alors cadette nominale, d'autant plus que ses gorgolaaBe C et D manifestent encore l'espérance d'enfants ultérieurs.
Enfin, ce cas concret nous fournit toutes les combinaisons, que le groupe social a l'habitude de considérer lorsqu'il s'agit de l'ordre de naissance 28 partiel ou global.
L'ordre partiel est double, pouvant être relatif soit à la mère commune soit au commun sexe des enfants d'une même mère. Dans le premier cas — relativité à la mère commune — trois sous-séries sont présentes, comptant chacune deux individus au moins, soit 1, 2, 3, 5, 7 en A, correspondant théoriquement à Hammadi, Sira, Samba, Demba et Kumba; puis 6, 8, 10 en C, également Hammadi, Samba et Demba; enfin, en D, les enfants 9 et 11, qui sont Hammadi, et Sira, mais d'autant plus conventionnellement que D a donné deux premiers enfants à un ménage précédent avant de devenir l'épouse de P.
Lorsque cet ordre partiel devient relatif au sexe des enfants d'une seule mère, il apparaît encore trois sous-séries comptant deux individus chacune, soit 1, 3, 5 (garçons), et 2, 7 (filles) en A; puis 6, 8, 10 (garçons) en C. La femme B n'a donné qu'une fille à ce ménage, et si D inaugure ici deux sous-séries, celles-ci sont pour l'instant faiblement représentées.
Quant à l'ordre global il est tout aussi double que le partiel. Par rapport au géniteur commun P, cet ordre global recoupe l'ordre numérique et va de 1 (afo) à 11 (kodda provisoire). Relativement au sexe des enfants, tandis que leurs mères sont écartées, deux sous-séries globales se trouvent présentes, à savoir 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10 (garçons) et 2, 4, 7, 11 (filles).
Les attitudes entre frères et soeurs 29 sont variables, selon l'âge et selon la parenté utérine ou consanguine qui les soude les uns aux autres. Jusqu'à 7-8 ans ils forment dans la maison familiale un groupe non encore différencié mais homogène, vivant au même rythme, familier des mêmes jeux, subissant la règle commune de soumission aux parents. Cependant très vite des frontières s'établissent entre eux, au moyen de la violence imposée par les plus âgés aux plus jeunes, ou bien le clivage intervient confusément entre eux tous et les enfants du voisinage à l'occasion d'un conflit quelconque, se muant d'ailleurs facilement en querelle des parents... Ainsi, par exemple, à l'intérieur de la concession familiale l'aîné exercera ses droits, en administrant la correction à ses cadets, bien que cette conduite lui soit en principe interdite par les parents. Tandis qu'au dehors, le même aîné se pose immédiatement en protecteur de ses cadets, les défendant contre l'agression, les consolant quand ils se sont fait mal en jouant. Si lymphatique que soit l'aîné, il se muera facilement en « terreur » (jaambaaro) sitôt que son cadet se trouve attaqué, autrement il recevrait la correction de ses parents pour s'être soustrait à son devoir (fodde).
Les frères et sœurs peuvent grandir parfaitement unis (siblings et utérins), ou bien indifférents voire hostiles les uns aux autres (consanguins). Dans un ménage polygame, il est fréquent que tous les enfants de la même mère fassent bloc contre leurs demi-frères et sœurs, attitude qui reflète fidèlement, au demeurant, l'hostilité latente entre les femmes de leur père commun. Les enfants dont la mère a connu plusieurs ménages, et qui de ce fait sont de pères différents, restent cependant fort unis en vertu de la filiation utérine (Bingu-yumma). Toutefois, c'est sous l'aspect aigu qu'ils prennent dans la relation de cousinage que seront considérés ces sentiments de tendresse ou d'hostilité, selon qu'ils procèdent de la parenté matrilatérale ou patrilatérale.
L'ordre de naissance est en fait capital, parce qu'il situe chaque enfant relativement à son frère ou à sa sœur comme aîné ou cadet, et fonde par conséquent un rapport social de domination-soumission. Car si infime que soit la différence d'âge entre l'aîné et le cadet, il n'empêche que le premier se voit reconnaître une primauté intangible sur le second. En contrepartie, celui-ci doit une obéissance sans restriction mentale : il fera les commissions de son aîné (ko cukolel nelete), lui marquera permanente déférence, et évitera d'être grossier ou simplement vulgaire en sa présence (teddinnde mawDo mum). Cette différence entre aîné et cadet culmine lorsqu'ils deviennent orphelins, parce que le premier se substitue automatiquement à leurs parents disparus (mawDo ma ko jinnaaDo ma).
L'aîné(e) sera mawnam gorko ou mawnam debbo selon le sexe masculin ou féminin, tandis que puînée(e) se dira minyam gorko ou minyam debbo. La sœur se désigne banndam debbo (ma parente) pour l'homme, qui sera banndam gorko (mon parent) pour celle dont il est le frère, et sans qu'il soit nécessaire, dans l'un et l'autre cas, de préciser l'âge supérieur ou inférieur de la personne en question.
En fait, dans leurs rapports mutuels le cadet ne nommera pas l'aîné par l'anthroponyme que celui-ci a reçu, mais il devra plutôt user respectueusement de deede, terme dont la signification littérale est « mon grand » ou « ma grande ». Alors que relativement à son aîné, le cadet sera minyel, « mon petit » ou « ma petite ». Le plus souvent, la personne concernée — homme ou femme — sera connue sous ce seul soowoore 30 de Minyel, qui efface à peu près complètement son anthroponyme de baptême.
Toutefois, l'usage de deede est actuellement tant soit peu suranné, d'autant plus que les jinnaaBe eux-mêmes se font interpeller par leurs propres enfants sans que l'anthroponyme soit aucunement précédé de la qualité correspondante de parent, à savoir baaba, neene, kaaw ou gorgol.
En outre l'aîné serait en passe de perdre ses droits, parce qu'il est souvent contesté dûment par son cadet. C'est ainsi qu'à compter de son adolescence, le garçon répugnera presque toujours à marquer la moindre soumission a sa sœur aînée, parce que de toute manière elle appartient à la catégorie des personnes inférieures. C'est ainsi qu'à partir de son mariage, la fille s'estimera suffisamment promue dans l'échelle sociale pour résister à la domination de ses frères et sœurs aînés : elle a échappé à leur semi-tutelle et changé de maître. Par ailleurs, entre aîné et cadet de même sexe, il sera coutumier que la différence d'âge relativement infime soit assumée moins correctement par le plus jeune. Et, quand par hasard il aura socialement réussi 31 autant que son aîné ou mieux que lui, il se considérera comme son égal ou alors il le méprisera et le traitera en inférieur, probablement pour se venger de sa situation durant le cours de leur jeunesse. Aux dires des principaux intéressés, le cadet complètement soumis à son aîné appartiendrait à un passé bien révolu : il subsisterait à la rigueur déférence nominale, mais toujours à l'affût d'une occasion pour se dissiper.
En tout cas, l'ordre de naissance, l'âge autrement dit a valeur fonctionnelle au plan de la collectivité sociale. C'est en effet, par sa médiation que s'opère l'insertion de toute personne dans le groupe; c'est par son intermédiaire que par-delà la famille concrète sa place est fixée dans la grande famille du quartier, puis du village tout entier. A la limite, si l'on suppose abolie la parenté, telles la filiation, la consanguinité voire l'alliance, il subsistera encore entre les personnes ce solide lien social qu'est l'âge, véritable modalité du banndiraagal. Avant son sens actuel de « parenté » sans précision de nature ou de degré, le mot banndiraagal ne signifie-t-il pas « associement des personnes » ou encore plus simplement « être-ensemble » ? Or. cet « être-ensemble » aura pour régulateur la consanguinité, d'où parenté au sens familial, ou l'âge commun, donc parenté au sens social (giJiraagal ko banndiraagal). C'est ainsi que cette communauté de l'âge (fedde) vaut fraternité pour tous ses membres, les uns par rapport aux autres et compte tenu des différences de sexe et de caste, fraternité putative se traduisant dans des appellations à nuance très affective comme laare et cooga.
Précisément, les fraternités d'âge (pelle) modèlent la communauté de quartier ou de village en une structure pyramidale, dont le sommet sera l'apanage des vieillards (mawBe raneeBe), le centre domaine des adultes (hellifaaBe pour les hommes, seemedBe pour les femmes), et la base fief des jeunes (sukaaBe les garçons, et boombi les filles). Chacune de ces trois parties admettra encore la division trinitaire; supposons en effet un membre de la base, un jeune par conséquent : il a parmi les jeunes, à compter des natifs du jour jusqu'aux franges entre jeunesse et âge adulte, des minyiraaBe (plus jeunes), giJiraaBe (même âge) et mawniraaBe (plus anciens), avec toutes les spécifications correspondantes de la parenté, soit frère, sœur et cousin. Les adultes situés immédiatement au-dessus seront entre eux dans les mêmes rapports qui lient les jeunes, ceux-là étant en outre jinnaaBe de ceux-ci, soit père, mère, oncle ou tante. Au sommet également les vieillards reformeront le schéma de la base et seront triplement liés à leurs prédécesseurs le plus souvent disparus, aux adultes dont ils sont les jinnaaBe, aux jeunes, enfin, dont ils sont les taaniraaBe et njaatiraaBe.
En fait, le concept d'âge est un élément constitutif de la structure sociale toucouleur, parce qu'il tisse entre les personnes des liens effectivement réels, intériorisés pour ainsi dire par les individus et réglant concrètement leurs rapports sociaux.
L'âge sera repéré au moyen du nombre d'heures (wakhtu - wakhtuuji), de jours (nyalngu - balDe), ou de nuits (jamma - jammaaji), de lunes ou mois lunaires (lewru - lebbi) et d'hivernages écoulés, à savoir années civiles (ndungu - duuBi ou bien hitaande - kitaale).
Mais, de toute évidence et en dépit de cette variété de concepts de la durée l'âge de la personne demeure souvent approximatif. Et c'est la raison pour laquelle il sera toujours largement fait appel aux phénomènes collectifs concrets pour cerner la durée abstraite : famine, inondation, sécheresse, épidémie, épizootie, invasion de criquets, etc.
Les modalités principales de la relation de cousinage à savoir cousins consanguins, cousins utérins et cousins croisés correspondent dans le système toucouleur aux termes respectifs de BiBBe-baaba, remmeraaBe et denDiraaBe. Il n'y a pas similitude de signification, toutefois, entre la notion de cousin et les termes qui la traduisent en langue toucouleur, parce que le contenu permanent de ces derniers est la fraternité, une fraternité aussi réelle que celle qui apparente des individus ayant mêmes géniteurs. Il ne peut guère en être autrement, si les frères et cousins du père, les sœurs et cousines de la mère sont respectivement pères et mères de l'individu de référence. Il est donc normal que les enfants du frère du père et ceux de la sœur de la mère soient des frères et sœurs, aîné(e)s et cadet(te)s selon le cas, à savoir deede et minyel. Tout se passe en définitive comme si la fraternité existant entre leurs différents jinnaaBe se transmettait, sans aucune altération, aux différents « cousins ».
L'on emploiera cependant le terme de cousin, mais en gardant constamment à l'esprit son impropriété relativement à la conception du groupe social toucouleur.
a) Les cousins consanguins (BiBBe-baaba)
Le premier et principal sens de BiBBe-baaba s'applique aux enfants d'un père unique (baaba gooto) et de mères différentes. Tous les enfants d'un ménage polygame, suivant l'exemple du tableau 7, sont BiBBe-baaba. Il en sera également ainsi dans la monogamie successive consistant en plusieurs unions non simultanées du même homme, unions dont chacune pourra être suffisamment durable pour procréer des enfants. Ceux-ci sont des BiBBe-baaba comme les précédents, leur fraternité procédant du père, autrement dit leur géniteur commun.
La seconde acception de BiBBe-baaba, qui correspondrait à la notion de cousins consanguins, comporte trois catégories. Les enfants des frères A et B (siblings) sont dans des rapports de BiBBe-baaba (seekodaaBe) comme si leurs deux pères étaient une seule et même personne. La preuve de cette identité entre A et B se manifeste dans la coutume du lévirat, qui fait de chaque homme l'héritier automatique de la veuve et des enfants de son frère, encore que le consentement de la veuve soit actuellement requis.
D'autre part, deux demi-frères A1 et B1 issus d'un père unique et de mères différentes, donc des BiBBe-baaba au sens premier du terme, donnent des enfants qui sont également BiBBe-baaba au second sens qui nous occupe. Enfin, deux individus A" et B" BiBBe-baaba (« cousins » et non demi-frères) donnent naissance à des enfants qui sont BiBBe-baaba les uns vis-à-vis des autres ; à la condition que A" et B" soient cependant cousins consanguins car s'ils sont cousins croisés ou bien utérins leurs enfants ne sont pas tout à fait BiBBe-baaba.
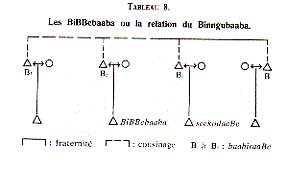
Les seekodaaBe sont des BiBBe-baaba ayant pour pères des frères siblings.
La première sorte de BiBBe-baaba suppose des taaniraaBe communs (grand-père et grand-mère patrilatéraux), la seconde un seul taaniraaDo (grand-père commun ou père des pères), la troisième au moins un njaatiraaDo commun (l'arrière-grand-père ou grand-père des pères).
La relation des « cousins » BiBBe-baaba (Binngu-baaba) comporte donc — le sens même des mots l'implique — la seule parenté patrilatérale, et à la condition minimale que celle-ci puisse remonter à la génération des grands-parents. C'est pourquoi les enfants de demi-frères utérins posent un problème à la classification, car au lieu d'avoir même grand-père patrilatéral ces enfants en auront deux bien distincts, la seule grand-mère patrilatérale leur étant commune. Sans doute, le lien objectif entre ces enfants, à savoir fraternité entre les pères, en fera des BiBBe-baaba apparents. Mais c'est un titre que le système leur conteste strictement en ce sens que leurs pères sont des utérins et non des consanguins : par conséquent les enfants seront des remmeraaBe, parce que précisément issus de remmeraaBe stricto sensu.
En fait, l'une et l'autre conceptions semblent également usitées dans toutes les régions du Fouta, tenant les enfants de frères utérins soit comme des BiBBe-baaba, soit encore comme des remmeraaBe. Et cette même ambivalence se retrouve dans les conduites : entre BiBBe-baaba le comportement est un mélange de froideur et jalousie, tous sentiments absents ou fort atténués chez les enfants ayant des utérins pour pères. La collectivité sociale, jugeant à cet égard plutôt d'après les conduites, répute les enfants d'utérins soit remmeraaBe soit BiBBe-baaba suivant que leurs relations sont étroites ou lâches.
Les BiBBe-baaba (ainsi que les remmeraaBe et les denDiraaBe kosam, dont il sera question infra) se situent les uns vis-à-vis des autres comme des frères et des sœurs, usant des mêmes termes banndam debbo et banndam gorko, deede (deedam, mawnam), minyel (minyam). Toutefois, il arrive souvent que les cousins ne s'en tiennent pas à cette assimilation, et précisent plus nettement la vraie nature de leur parenté. Ainsi, lorsque l'on présente sa cousine consanguine la formule est à trois « niveaux » :
o ko banndam debbo (sexe), minyam (âge), Bi-baabam (consanguinité) — Voici ma sœur (femme apparentée à moi), ma cadette, fille de mon père.
b) Les cousins utérins (remmeraaBe)
Sous l'aspect de la parenté matrilatérale, BiBBe-yumma est rigoureusement le symétrique des BiBBe-baaba de la parenté patrilatérale. Cependant remmeraaBe est plus usité que BiBBe-yumma, tous deux exprimant une seule et même réalité, tandis que le second est plus directement significatif. En tout état de cause, originaire de la langue des Sarakolle (proches voisins des Toucouleur, et ethniquement mélangés à ceux-ci), le radical remme est dans ladite langue l'équivalent de BiDDo (enfant), dans l'acception générale de ce mot. Reste néanmoins à savoir comment s'est opéré le passage du sens originel sarakolle au sens particulier d'utérins dans la langue toucouleur ?
Les remmeraaBe se répartissent selon les mêmes catégories que les BiBBe-baaba. Le fait pour deux mères d'être sœurs siblings crée entre leurs enfants la relation de remmeraagal au sens fort du terme. Lorsque les femmes sont demi-soeurs utérines leurs enfants sont également des remmeraaBe, tandis que les enfants de demi-soeurs consanguines relèvent de l'ambivalence déjà rencontrée au sujet des enfants de demi-frères utérins. En tout état de cause, il semble que les enfants de demi-sœurs consanguines soient plus volontiers réputés remmiraaBe que ceux des demi-frères utérins. Car les premiers remplissent une condition immédiate, qui est parenté patrilatérale de leurs mères, mais parenté patrilatérale devenue effectivement matrilatérale en considération des enfants de ces mères. Au contraire, les enfants de pères utérins s'éloignent de ce schéma puisque leur parenté utérine initiale s'est muée en consanguinité. Et si les uns comme les autres ne sont pas des remmeraaBe vrais, les enfants de mères consanguines se rapprochent davantage de la qualité, autant que ceux de pères utérins sen éloignent pour être plutôt BiBBe-baaba.
La troisième catégorie des remmeraaBe, après les sœurs siblings et les demi-sœurs utérines, est originaire des cousines. En effet, deux remmeraaBe (cousines utérines) donnent naissance à des enfants qui sont remmeraaBe entre eux, au même degré de parenté que celui existant entre leurs mères. Quant aux cousines croisées, et davantage encore les cousines consanguines, leurs enfants se trouvent à la rigueur assimilés remmeraaBe, par la médiation du lien existant entre leurs mères, et parce que la parenté entre les mères crée précisément une sorte de remmeraagal à la génération suivante.
La personne de sexe masculin que présente sa cousine utérine et cadette sera : o ko banndam gorko (sexe), mawnam (âge), Bi-neenam (parenté). « Voici mon frère (mon parent mâle), mon aîné, fils de ma mère. »
La relation de parenté dite Binngu-yumma (au sens restreint des utérins), ou ennDam (au sens originel des membres du groupe matrilinéaire) est spécialement caractérisée par la solidité (jiidigal tiDngal), du lien qui attache l'individu à ses demi-frères et sœurs maternels, aux frères et soeurs de sa mère et à leurs enfants.
Cette parenté, dûment centrée sur la mère, est fortement valorisée dans l'adage : Do yumma ala jam wonata, « la paix ne saurait demeurer où la mère ne se trouve pas ». En fait, ce sera une solide disposition à la compassion, exprimée par le rassemblement immédiat des individus chaque fois que le deuil les atteint, comme s'ils voulaient ce faisant ressouder leurs rangs brisés ; les circonstances heureuses, tels le mariage et le baptême, auront également pour résultat de réunir presque entièrement les apparentés maternels, quelle que soit la distance qui les sépare habituellement. Dans le Binngu-yumma ou ennDam l'instinct dit grégaire est certainement plus radical et plus ostentatoire que dans telle autre relation de parenté, comme le Binngu-baaba.
Les BiBBe-yumma (demi-frères et cousins utérins) se familiarisent fort vite, et il semble que la parenté de cet ordre soit davantage susceptible de se doubler d'une amitié sincère et durable. L'on parle également d'un tropisme qui fonctionnerait entre les individus de cette catégorie : quand ils se retrouvent fortuitement à tel endroit où aucun d'eux n'avait initialement formé le projet de se rendre, le hasard ne sera pas invoqué mais l'explication de la rencontre sera fournie par la formule ennDam ena uura, « la parenté maternelle produit entre ses ressortissants des effluves, qui les attirent ou les poussent les uns vers les autres ».
En tout cas, lorsqu'il lui est donné de choisir entre plusieurs gîtes, le voyageur marquera sa préférence pour un membre de son ennDam, chez lequel il est toujours le bienvenu et traité mieux que partout ailleurs.
Une personne connue pour sa volonté de paix et d'unité sociales, et dont le programme d'action quotidienne est la défense de ces thèmes, à la fois dans sa propre famille et au sein de la collectivité villageoise, sera sacrée jokkoowo ennDam (jokkere ennDam) pèlerin de l'entente. L'envers de cette vertu est taJenn-Damaagu, et son militant honni le taJoowo ennDam, essentiellement préoccupé de susciter de solides haines entre voisins, au moyen du mensonge et de la délation savamment dosés.
Différent du Binngu-yumma, le Bingu-baaba ou duhol semble avoir pour contenu une sentimentalité surtout négative, et un esprit de compétition. Celui-ci se manifeste pour chaque Bi-baaba dans le refus de se laisser distancer par l'autre, quand cet autre est du même sexe.
— « Ko waawi fof mbeDe waawi, ko haandi kala mbeDe haandi heen, sabu o Buranimi : Tout ce qu'il (le Bi-baaba) peut faire, je suis capable de le réussir et je mérite tout succès qui lui échoit, car il ne m'est aucunement supérieur. »
C'est sans doute la raison pour laquelle il apparaît si souvent entre BiBBe-baaba (demi-frères, et cousins consanguins) l'ostentation, l'émulation et la surenchère informulées ou franchement agressives. Le succès particulier de l'un d'eux, au lieu de rejaillir sur les autres, sera l'affirmation d'une personnalité et l'étouffement conséquent de ses BiBBe-baaba, qui en éprouveront intérieurement beaucoup d'envie et peu de fierté.
Dévoués réciproquement jusqu'au sacrifice seront les BiBBe-yumma, alors que les BiBBe-baaba se tiennent pour des concurrents mutuels et se méfient les uns des autres. Deux personnes étrangères sur le plan familial, mais qui se prennent en très grande amitié, seront assimilées à des utérins : « elle ko Be BiBBe-yumma ». Par contre, les rapport inamicaux et les disputes fréquentes entre individus apparentés ou non font identifier leur conduite à celle des consanguins : « elle ko Be BiBBe-baaba ».
Il est certain que l'individu ressortit socialement et activement à son groupe patrilinéaire, mais en prenant conscience de sa personnalité il prend conscience du bloc monolithique formé par son clan matrilinéaire, auquel il s'intègre profondément.
En définitive, la dimension maternelle de la parenté sera assumée en termes d'unité et d'assistance réciproque, alors que le secteur paternel apparaîtra comme un fait auquel on se soumet, et dont le retentissement psychologique peut être froideur et coexistence pacifique ou bien hostilité ouverte.
Bien sûr, il s'agit là de stéréotypes familiaux et sociaux que la réalité courante peut parfaitement infirmer. Car il n'est nullement prouvé que les relations d'utérins soient toujours excellentes, ni que celles des consanguins soient radicalement inamicales. Néanmoins, un conflit intrafamilial aura souvent chance de devoir son origine à l'un des sentiments négatifs caractéristiques du Binngu-baaba.
c) Les cousins croisés (denDiraaBe kosam)
Les personnes dont les mères sont apparentées selon des modalités déjà analysées ressortissent à la relation de Binngu-yumma,
qui se mue en Binngu-baaba quand des modalités presque identiques se retrouvent entre leurs pères. D'une certaine manière, la relation pourrait être définie parallélisme entre cousins consanguins ou bien entre cousins utérins.
Or, les denDiraaBe kosam (kosam = lait ; c'est l'indication de
la vraie parenté, par opposition à la parenté à plaisanteries qui se dit njongu)
n'obéissent pas à ce parallélisme, car le père de l'individu A sera non pas apparenté au père de l'individu B mais à la mère de celui-ci.
La notion de « croisement » est contenue dans le terme même de denDiraaBe,
terme suggérant un « mélange » sinon une certaine « complexité ». Selon l'accent mis sur la sœur du père ou au contraire sur le frère de la mère, denDiraaDo deviendra
soit Bi-gorgol soit Bi-kaaw. Des termes distincts seront nécessaires pour traduire les deux perspectives patrilatérale et matrilatérale d'une seule et même catégorie de la parenté, le denDiraagal.
D'une part, les denDiraaBe kosam disposent des mêmes termes qui permettent aux frères et cousins (consanguins et utérins) de se nommer, en se situant les uns par rapport aux autres. D'autre part, ils partagent avec les denDiraaBe njongu les
dénominations telles que denDi (cousin !), ko denDam (c'est
mon cousin). Peut-être s'ensuit-il quelquefois une certaine confusion, quand les mêmes appellations valent pour des formes de parenté somme toute distinctes. Toutefois, à défaut de brièveté et concision, l'on dispose encore d'expressions qui subsument les catégorie, sexe et âge des cousins croisés :
Telles sont les quatorze modalités de denDiraagal kosam relativement à un individu donné, soit sept catégories de BiBBe-kaaw et autant de BiBBe-gorgol. A ces modalités réelles d'autres pourraient encore s'ajouter, par l'application du principe qui dispose qu'entre deux denDiraaBe kosam tout denDiraaDo de l'un est denDiraaDo de l'autre, et réciproquement.
d) Les cousins à plaisanteries (denDiraaBe njongu)
La condition d'existence du denDiraagal kosam étant fraternité entre la mère de l'un et le père de l'autre denDiraaBe, il semble que cette double présence maternelle et avunculaire incline sinon à la solidarité, tout au moins à l'absence d'hostilité entre les tenants de cette forme de parenté.
A cet égard, les conduites requises à l'intérieur du denDiraagal kosam contiennent des indications. C'est ainsi que le jour où la fille mariée quitte définitivement sa famille pour s'installer dans la case nuptiale, elle devra préalablement à son départ procéder au don de la totalité de l'habillement reçu de ses père et mère, les bijoux exceptés. Dans l'ordre de parenté, c'est la plus proche denDiraaDo, mariée ou impubère, qui doit bénéficier de cette disposition.
D'autre part, la même jeune épouse franchira le seuil des concessions familiale et conjugale, en cette solennité du rapt (ndiiftungu), assise sur la croupe d'un cheval dont le cavalier ne peut être que le denDiraaDo (Bi-kaaw) de la mariée.
L'attributaire de vêtements est BiirtinaaDo comci, le cavalier baDDinoowo ndiiftungu, fonctions auxquelles s'ajoute celle de dokkaDo suudu. Est dokkaDo suudu (ou joom suudu) non point l'épouse effective, mais telle parente de l'homme qui fonde un foyer : banndiraaDo debbo, Bi-baaba, denDiraaDo ou remmeraaDo du marié, respectivement ses sœur, cousine consanguine, cousine croisée ou cousine utérine. Le nouveau chef de famille investira indifféremment dokkaDo suudu (celle à qui est donnée la case nuptiale) l'une ou l'autre de ces quatre parentes, et généralement la plus âgée d'entre elles. Le rôle de la dokkaDo suudu consiste huit journées durant à présider effectivement les noces de son frère ou cousin, en ayant la haute main sur le déroulement de l'événement, et sur l'installation adéquate de la mariée dans son nouveau logis.
Une fois par an et parfois plusieurs, à l'occasion des grandes fêtes religieuses, la tradition familiale fait obligation à la Bi-gorgol de laver (sembude) les pieds de son Bi-kaaw. Elle peut accomplir symboliquement ce devoir, au moyen d'un cadeau dit cembudi juulde. Boule de savon local, savonnette parfumée, flacon miniature de parfum — à peu près régulièrement l'un des attributs de l'hygiène corporelle — ce cadeau, bien qu'il appelle contre-don de celui qui le reçoit, se présente davantage comme renouvellement d'allégeance de Bi-gorgol à Bi-kaaw.
Mais, en dépit de cette solidarité manifestée entre denDiraaBe kosam à l'occasion des précédentes fonctions, la règle sociale est que les « cousins croisés » se moquent, voire se calomnient mutuellement. Chacun d'eux, à tout moment, peut dévoiler les travers de l'autre pour faire rire à ses dépens.
L'antagonisme simulé et jovial — présent notamment entre aïeul et descendant, camarades de même âge (giJiraaBe) et frères communautaires (sattidiiBe) — est également la règle des rapports entre denDiraaBe kosam. Ce simulacre d'antagonisme entre cousins croisés apparaît aussi comme un premier niveau de l'effectif cousinage à plaisanteries, lien qui attache mais pour affronter dûment des individus appartenant à des familles notoirement distinctes (denDiraaBe njongu). N'est-ce pas, au demeurant, le même terme denDiraagal qui signifie à la fois parenté des « cousins croisés », et parenté des « cousins à plaisanteries » ? Peut-être kosam et njongu auraient-ils alors pour fonctions de préciser chacune des deux sources familiale et sociale — sources différentes mais non opposées — où l'individu peut puiser une certaine liberté de langage et de comportement, à l'égard de son prochain. Et, à supposer qu'il en soit ainsi, laquelle des deux sources doit être tenue pour historiquement antérieure, et comment la seconde procède-t-elle de la première ? Existe-t-il entre elles rapport causal, ou bien leur genèse respective est-elle autonome ? En tout cas, leur différence immédiate est seulement le degré, familiarité limitée par une certaine pudeur dans le cas du denDiraagal kosam, contre familiarité effrénée du njongu, mais proportionnée toutefois à la présence ou à l'absence de parenté familiale effective entre les jongidiiBe (cousins à plaisanteries).
La difficulté majeure du denDiraagal njongu consiste probablement dans le grand nombre de légendes qui se disputent l'explication de son origine. Selon toute apparence, chacune de ces légendes cernerait un aspect particulier de la question, à moins qu'il ne s'agisse de versions locales d'un même phénomène originel, ou encore, que chaque couple de denDiraaBe patronymiques ait son histoire propre.
Aux dires de l'une de ces légendes :
« Les hommes, groupés jadis en hordes nomades, étaient caractérisés notamment par la pudeur, l'égoïsme, la réserve et la crainte, la seule violence réglant leurs rapports, au moyen de la spoliation ou de la guerre, du rapt et de l'asservissement. Or, un jour, par le plus inattendu des hasards, au lieu d'être fidèle à la règle commune en s'appropriant par la violence le bien d'autrui, voici qu'un individu innove au contraire et introduit la méthode persuasive. Et, le propriétaire du bien convoité — chose surprenante — de répondre favorablement à son solliciteur :
— « Bam ! ko enen ndendi. » (Prends ! ce bien nous appartient à tous les deux.) Le solliciteur surpris de cette disposition insolite, et ne voulant pas demeurer en reste, de répondre :
— « kaatudi ngurndam meeDen, en coori denDiraagu » (Pour le restant de nos jours, nous achetons (échangeons) le droit de partage, ou encore: — Désormais ce qui appartenait à chacun de nous appartient à tous les deux). Ainsi, avec la générosité et l'altruisme naissait le contrat de l'échange amiable, le prêter et rendre, le donner et recevoir.
A la suite de quoi, la réserve naturelle entre voisins, la trop grande pudeur et l'égoïsme disparaissaient progressivement, pour céder le pas à d'autres types de rapports humains. Et voilà que l'on n'a plus scrupule à solliciter son voisin, puisqu'il y a espoir d'obtenir sans recourir à la spoliation du propriétaire, lequel est par ailleurs de moins en moins contraint d'être sur ses gardes, car de plus en plus rarement pillé. »
Cette origine supposée de la parenté à plaisanteries, origine confondue avec l'émergence de l'altruisme et du communautarisme, aurait en tout cas laissé une trace dans la latitude reconnue à chaque denDiraaDo, de soutirer à son homologue une partie de son bien (nGuunyde denDum).
La parenté à plaisanteries aurait donc procédé d'une conduite individuelle novatrice, qui aurait en outre suffi pour modifier les rapports humains en les dégelant. Toutefois, l'argumentation de cette légende — réduite à la seule apparence de relation sémantique entre denDiraagu (denDiraagal) et rendude (posséder en copropriété; se rassembler; s'unir) — est peut-être insuffisamment convaincante. De toute manière, cette légende ne semble contenir nulle indication sur la très probable relation entre denDiraagal kosam et denDiraagal njongu, pas plus qu'elle ne suggère comment s'opère le passage de la parenté à plaisanteries en général à la relation particulière entre tel et tel patronymes.
L'on a, néanmoins, l'habitude de distinguer deux catégories principales à l'intérieur du denDiraagal njongu : la première qui sera pour ainsi dire intra-ethnique, ou relation entre certains patronymes des Toucouleur 32, et la seconde définie comme inter-ethnique, à savoir affinité entre Haal-pulaaren, d'une part, et SereraaBe (Serer), d'autre part, considérés comme deux entités sociales. En d'autres termes, si son patronyme donne à un quelconque Haal-pulaar un nombre déterminé de denDiraaBe njongu parmi les Haal-pulaaren, en revanche son appartenance ethnique toucouleur en fait le denDiraaDo de n'importe quel Serer, et réciproquement.
Haal-pulaaren et SereraaBe auraient été un seul et même peuple à l'origine, les seconds ayant pu devoir leur nom au fait qu'ils rompaient avec les premiers (en Pulaar seerde = se séparer, répudier) dans la région de Podor, pour s'établir principalement dans la province sénégalaise du Siin (Sine).
En tout état de cause, à défaut d'autorité décisive, le cousinage à plaisanteries offre néanmoins un certain renfort à la thèse qui donne aux Serer et Toucouleur une origine ethnique commune. En effet, la légende rapporte la genèse du cousinage existant entre SereraaBe et Haal-pulaaren en ces termes :
« Deux frères voyageant de concert firent halte en cours d'étape, parce que la faim les talonnait. L'aîné des deux compagnons, pénétré de sa responsabilité à l'égard du cadet dont il a la charge, et conscient du fait que sa mort par inanition lui serait imputée à crime, s'enfonça alors dans la forêt. Quand il s'assura qu'il était hors de la vue de son frère, il sacrifia un morceau de sa cuisse qu'il fit griller, pour en supprimer toute trace d'origine. Après quoi, il revint vers le cadet inanimé et lui tendit le morceau, présenté comme partie du gibier que la providence venait d'offrir aux affamés. Le cadet se restaura, et les deux frères purent poursuivre leur voyage pour parvenir à destination.
« Longtemps après, la cicatrice profonde provoquée par l'ablation devait trahir le secret de l'aîné, que son frère surprit endormi : éperdu de reconnaissance pour le sacrifice 33 auquel il devait la vie, le cadet jura allégeance perpétuelle à son sauveur et fit le serment que sa descendance resterait fidèle à celle de l'aîné. Le cadet serait l'ancêtre des Haal-pulaaren, et l'aîné celui des SereraaBe: C'est la raison pour laquelle les uns et les autres sont aujourd'hui encore des cousins à plaisanteries 34. »
Cette légende des deux frères, qui postule un « pacte du sang » initial entre Haal-pulaaren et SereraaBe, serait à tout le moins en apparente contradiction avec l'origine des seconds. En effet, le point de départ de l'ethnie Serer aurait été séparation radicale et définitive d'avec les Haal-pulaaren, tandis que le « pacte du sang » indique au contraire unité formelle et cohabitation. Dans ces conditions, il est alors probable que le clivage géographique serait intervenu postérieurement au pacte, à savoir qu'au moment de leur séparation Haal-pulaaren et SereraaBe, déjà constitués comme groupes distincts 35, étaient depuis fort longtemps denDiraaBe njongu.
Et leur séparation n'aurait eu aucune influence sur un pacte demeuré sacré en dépit de toutes les vicissitudes.
En tout état de cause, notre légende affirme que les denDiraaBe njongu étaient d'abord des consanguins dont la parenté à plaisanteries est consécutive à un pacte du sang, lequel pacte confère à l'un une supériorité achetée sur l'autre individu, ce dernier en conséquence même de la vente s'attribuant l'infériorité (njongu ou coggu : échange par achat et vente).
Tels sont donc les éléments — couple du supérieur et de l'inférieur fondé sur un pacte originel — régulièrement présents dans les deux genres de denDiraagal, à savoir kosam et njongu, c'est-à-dire cousins croisés et cousins à plaisanteries.
Avant d'entrer dans le détail de la catégorie intra-ethnique du njongu, l'on rappellera brièvement que tout denDiraaDo aborde son parent oppositif au moyen du terme denDi (cousin!), et qu'il le désigne en usant de la formule démonstrative : o, ko denDam : Voici mon cousin à plaisanteries.
La catégorie intra-ethnique du denDiraagal njongu, qui est parenté à plaisanteries instituée entre Toucouleur par le truchement de leurs patronymes, apparaît évidemment complexe en raison du nombre considérable de patronymes. Nous avons précédemment aperçu que ces noms de famille ou noms claniques pouvaient être spécifiques à telle caste, ou bien être communs à plusieurs castes. L'on se rappelle à cet égard que Aany est toujours de caste toorodo, Mbenyuga étant ceDDo, Saar cubballo, Daf jaawanDo — les jaawamBe ne partageant leurs patronymes avec nulle autre caste — Mbuum gawlo, Gajigo labbo, Mboh baylo, Gaako sakke et Gise maabo. En revanche, Njaay sera indifféremment tooroodo, ceDDo, ou maccuDo, Caam tooroodo, ou baylo, Soh (peul), tooroodo, maccuDo, labbo, ou cubballo. Sans compter les patronymes originaires d'ethnies différentes, et dont les porteurs se sont assimilés au milieu toucouleur d'adoption, tels Hameyti maure harattin (capaato hardaane) 36, NgayDo peul, Gasama (ou Gasamme) sarakolle, Konaate bambara, Fofana manding, Faal wolof, etc.
La complexité du njongu intra-ethnique ne s'arrête encore nullement à cette variété illimitée des patronymes ni à l'hétérogénéité de leur distribution entre les diverses castes toucouleur ; il faut y ajouter les nuances voire les différences locales, la moindre d'entre elles tenant au fait que deux patronymes denDiraaBe dans une région déterminée seront, au contraire, parfaitement indifférents dans une autre province du même Fouta Tooro.
En tout cas, le njongu intra-ethnique sera davantage relations entre les patronymes, les familles autrement dit, qu'affinité entre les castes. Sans doute, à titre pour ainsi dire exceptionnel, le maabo (tisserand ou chanteur), par le fait même de sa caste globale d'appartenance, se trouve en relation de denDiraagal avec n'importe quel porteur du patronyme de Sal 37; sans doute, les TagankooBe et OrmankooBe sont à titre d'originaires maures (esclaves en rupture) les cousins à plaisanteries de la caste générale des jaawamBe. Mais, ces deux exemples ne permettent pas d'inférer des relations de plaisanteries entre les castes, car les TagankooBe et OrmankooBe ne sont pas des maures stricto sensu, et de toute évidence le patronyme Sal n'est spécifique d'aucune caste, puisqu'il est présent chez les tooroBBe, seBBe, subalBe, etc.
L'on est en conséquence fondé à admettre que le njongu intra-ethnique oppose les seuls patronymes (familles), et non les castes Au demeurant, cette seconde éventualité supposerait d'abord une patronymie spéciale à chaque caste, ce qui n'est vérifié que fort exceptionnellement comme on l'a vu en son temps. Par ailleurs, la parenté à plaisanteries entre castes serait assez difficilement conciliable avec la présence effective de cette même parenté entre les patronymes ressortissant à une seule et même caste. Ainsi, Caam et Ly (tooroBBe) sont denDiraaBe, de même que Aany et Talla également tooroBBe. Il en va semblablement de Nyaan-Njaade, et de Daf-Bookum (jaawamBe), de Nyang-Mbay et de Mbuum-Samm (awluBe), enfin de Njaay-Joop (seBBe). Et s'il apparaît que les deux patronymes denDiraaBe sont de castes différentes, comme Jaw (cubballo) — Sek (gawlo); Caam (baylo) — Ly (tooroodo) ; Aany (tooroodo) — Fofanna (ceDDo); Kamara (maccuDo) — Ja (tooroodo), la caste n'en demeure pas moins parfaitement secondaire, et essentiel le clan patronymique. Enfin, si l'on tient pour accordé que le denDiraagal inaugure le seul simulacre de hiérarchie entre les personnes, la caste s'en trouverait exclue par le fait même. Car la caste est déjà hiérarchie, c'est-à-dire supériorité et infériorité dans le cadre d'une société stratifiée. Etant déjà et par nature opposée effectivement à d'autres castes, la caste ne saurait plus se suffire ni même faire acception de l'opposition simulée du denDiraagal.
Le denDiraagal serait en définitive simple relation entre clans patronymiques, y compris lorsque lesdits patronymes appartiennent à des ethnies différentes, car il semble que ce soit invariablement la seule contiguïté géographique qui crée la parenté à plaisanteries. En effet, le denDiraagal apparaît comme un modus vivendi entre les clans qui partagent le même territoire. Ainsi, se trouverait peut-être expliquée la parenté entre Serer et Toucouleur avant l'émigration du premier groupe. Cette parenté lie encore les Toucouleur à leurs voisins traditionnels Sarakolle, Peul et Maure, indépendamment des brassages intervenus depuis plusieurs siècles. C'est pourquoi Bacily (sarakolle) sera le denDiraaDo de Sy (toucouleur ou maure), Lamm (toucouleur) celui de NgayDo (peul), ou celui de Sakho (sarakolle ou toucouleur). Naturellement Jaabi (maure) sera le cousin à plaisanteries de Daf (toucouleur).
Qu'il soit présent à l'intérieur d'une seule caste toucouleur, ou intervienne comme relations réciproques entre castes distinctes de la même ethnie, sinon entre ethnies différentes, le cousinage à plaisanteries sera essentiellement caractérisée par trois faits majeurs. D'abord la perpétuité du lien entre cousins, ensuite, la « solidarité mécanique» consécutive à ce lien, enfin, malgré tout, l'opposition hiérarchique créée par le lien entre ceux qu'il associe effectivement.
Le caractère durable voire indestructible du lien entre denDiraaBe est souligné par les réactions que la parenté à plaisanteries serait susceptible de provoquer jusque dans la mort. En effet, selon la conception collective, « si d'aventure un denDiraaDo vient à passer à proximité de la tombe (yanaande) de son cousin à plaisanteries, en omettant de houspiller même mentalement le défunt, celui-ci ne manquera guère de s'interroger sur la froideur inaccoutumée de son ancien acolyte :
— « Pourquoi ne me manifeste-t-il aucune attention aujourd'hui, lui qui était si familier avec moi jadis ? Qu'a-t-il bien pu apprendre sur mon compte, pour se résoudre à m'ignorer?» se demandera le mort très contrarié.
Pour soustraire le défunt denDiraaDo à ce genre de tourment, il faudra lui adresser des quolibets comme s'il était bien vivant 38 ».
Cette croyance populaire exprime un mythe fort répandu, qui affirme la coexistence des vivants et des morts, les premiers demeurant visibles et audibles aux seconds, tandis que ceux-ci sont évidemment incapables de manifester leur « présence ». La mort n'est donc pas saisie comme anéantissement irréversible de l'être mais comme simple achèvement de son temps de vie terrestre. Il s'ensuit une mutation provisoire du disparu dans un univers de transition, sorte d'étape et de trait d'union entre Terre et Ciel, en attendant que les autres vivants aient épuisé à leur tour le temps qui leur est imparti. C'est seulement à dater du moment où tous les êtres vivants auront été mutés dans l'univers de transition, que la « fin définitive du monde » (darnga) serait effectivement réalisée.
Quant à ce caractère que l'on a baptisé « solidarité mécanique » entre denDiraaBe, il vient du fait que les cousins à plaisanteries, avant de se donner pour adversaires, sont en réalité des associés d'un certain genre. Tout d'abord, ils sont tenus de partager toute nourriture carnée, et cette nourriture seulement : si une personne quelconque égorge un animal, que ce soit sacrifice rituel, ou consommation courante, ses cousins à plaisanteries ont une option sur le morceau dit daande 39 denDiraaBe. Ce morceau était jadis porté au domicile du plus proche denDiraaDo, comme offrande volontaire du sacrificateur de l'animal. Il pouvait aussi échoir automatiquement au denDiraaDo présent au sacrifice, uniquement en raison de sa présence non délibérée, et parce qu'il était dûment qualifié pour incarner symboliquement tous les autres denDiraaBe de l'immolateur. L'aliment carné, obtenu seulement après avoir versé le sang, fait peut-être une allusion trop claire au pacte du même nom, pour que les denDiraaBe ne se sentent pas tenus de le partager régulièrement entre eux, même si c'est de manière inégale et symbolique. En tout cas, le partage de l'aliment carné n'est pas fortuit puisqu'il est authentifié effectivement par le nom même du morceau, également indicateur de son attributaire de prédilection.
Le second aspect de cette solidarité mécanique entre denDiraaBe est suggéré par la forme du lien créé entre les cousins: c'est une si étroite similitude, que la fraternité gémellaire seule pourrait, peut-être, en offrir l'équivalent. De sorte que le cousin à plaisanteries correspond à une sorte d'alter ego, qu'il faut aimer tel que l'on s'aime soi-même. Il ne faudra jamais lui porter préjudice ni lui faire la moindre peine, car si le denDiraaDo ne pardonnait pas, l'on s'attirerait directement et proportionnellement un malheur, selon l'adage courant :
— sa huBBini Bernde denDe a yiitat, à savoir: « Tu auras sûrement à souffrir pour avoir donné la souffrance. »
Le denDiraaDo au sens fort c'est, d'autre part, une personne irrésistible : en effet, celui dont on a longuement supplié une faveur mais qui persiste à fermer son cœur se laissera immédiatement fléchir, sitôt que se trouvera énoncée la formule « waDi njongu », à savoir:
— « Accorde-moi cela au nom du pacte qui nous lie. » L'invocation du njongu, à l'instar du lait de la mère, waDi kosam !, est un argument auquel il apparaît que l'on résiste assez exceptionnellement.
Cependant, ces deux précédentes caractéristiques du njongu, c'est-à-dire rémanence du lien jusque dans l'univers de l'ineffable et solidarité mécanique entre ses tenants, sont toujours des aspects masqués par un troisième qui est aussi le plus courant. En effet, le denDiraagal est un rapport d'opposition entre personnes, mais opposition inégalitaire dans son principe: deux denDiraaBe formeront toujours antinomie du supérieur et de l'inférieur, de l'homme libre (dimo) et de son esclave (jyaaDo). Baa sera par exemple le dimo de Jallo ou Kan, son JyaaDo, tandis que le Toucouleur a pour dimo le Serer. Mais c'est aussi une relation instable, où la situation des protagonistes est soumise à mutations permanentes selon leur comportement. Car le denDiraagal est émulation perpétuelle, oscillations du même individu entre les polarités de la supériorité et de l'infériorité. Oublier ses chaussures ou sa coiffure après le repas, ou les confondre simplement avec celles d'autrui, conserver une denrée alimentaire dans un pan de son vêtement, voilà autant de signes caractéristiques de la gourmandise de leur auteur. La négligence est également réprouvée, qui peut par exemple se manifester dans le port d'un vêtement à l'envers. Sans compter maints autres défauts telles la paresse et la peur, pour ne s'en tenir qu'à ceux-là.
En général, tous les manquements individuels infériorisent (saalitde) dûment celui qui s'en rend responsable en présence de son cousin à plaisanteries, lequel gagne par conséquent la supériorité (ndimaagu). C'est que dans la morale sociale d'antan, toute faiblesse humaine était pour ainsi dire synonyme d'irresponsabilité (huywere 40 ou Bocoonde 41), qui faisait à peu près sûrement de son homme la proie désignée au rapt et à la servitude. Aujourd'hui en revanche, si le jyaaDo prend son dimo en flagrant délit, il suffira simplement au second de se « racheter » en perdant la pièce à conviction (vêtement, coiffure ou chaussures), celle-ci devant automatiquement changer de propriétaire.
Pour prendre une vue d'ensemble du denDiraagal, l'on dira qu'il consiste pour le dimo à donner constamment la preuve de sa supériorité 42 sur son jyaaDo conventionnel, lequel est à l'affût des faiblesses éventuelles de son opposé, pour en tirer profit, Quant au jyaaDo, c'est-à-dire l'inférieur par nature, il a par conséquent plus grande latitude de conduite, dans la mesure où sa réputation est plus difficilement ternie. Néanmoins, s'il est publiquement pris en défaut, il lui faut offrir une compensation au denDiraaDo correspondant, c'est-à-dire son dimo conventionnel.
Reste la violence verbale qui égalise dimo et jyaaDo : chaque denDiraaDo peut, à sa guise, à tout moment et n'importe où, en user à l'endroit de l'autre, mais à l'exclusion de révélations attentatoires à l'honneur. Il est, en effet, préférable de taire ces délits que la morale réprouve, quand l'auteur en est denDiraaDo, autrement ce ne serait plus du simulacre. L'on s'en tiendra généralement à l'anodin : le denDiraaDo sera chargé d'un défaut quelconque, qui n'est pas forcément sien, ou bien l'on s'en prendra à sa famille en contant une mésaventure vénielle arrivée à son père ; l'on pourra également aller faire du tam-tam et danser (fijande) chez le denDiraaDo, pour le contraindre moralement à racheter une faute. En définitive, l'éventail des comportements observables entre denDiraaBe est très large, mais il dépend à la fois des tempéraments et de l'humeur du moment, voire du degré de familiarité pour que la violence verbale (yano) soit acceptée par la victime, ou se mue au contraire en violence des gestes (hare).
Selon les coutumes légendaires toucouleur, il était de pratique fréquente que l'homme épousât la fille de sa sœur (nièce), voire sa propre fille ; ces unions incestueuses remonteraient toutefois à un temps immémorial, car elles étaient déjà tombées en désuétude complète lorsque l'Islam a triomphé du paganisme. Dans son interprétation courante, le code islamique précise les alliances matrimoniales absolument prohibées 43 sous peine de châtiment corporel voire décapitation des contrevenants.
L'on ne doit prendre pour épouse ni sa propre fille (Byam), ni la fille de son frère (Byam). L'on ne peut davantage convoler avec sa sœur (banndam debbo), ou avec la fille de cette sœur (baaDam debbo), ni avec la sœur du père (gorgolam), ou celle de la mère (neenam), ni, enfin, avec cette mère (neenam). D'autre part, l'union matrimoniale est catégoriquement interdite avec la fille de l'épouse (baaDam ou njuteen), comme avec la mère de l'épouse (esiraaDo debbo). Enfin, par-delà la parenté par le lait (sœur ou nourrice) qui est une cause rédhibitoire, il n'est pas permis de réunir deux sœurs dans un même ménage, sauf à prendre la seconde en substitution (lomtaade e suudu) de la défunte première. C'est la coutume du sororat, mais qui est aujourd'hui en évolution, parce qu'elle a pratiquement perdu son caractère contraignant et immédiat. A cet égard, il semble plutôt que les hommes abandonnent de moins en moins à leurs parents l'initiative du choix de l'épouse, la tendance étant davantage celle de l'engagement personnel de l'intéressé, engagement que la famille entérine ensuite, et quand bien même son point de vue serait différent.
En ce qui concerne la femme, toutefois, il n'y a encore qu'apparente initiative du point de vue de l'engagement matrimonial. Elle sera sans doute informée immédiatement de toute démarche visant à l'obtention de sa main, si elle est encore jeune fille (mboomri). Tandis que si elle est divorcée ou veuve (diwo), tout nouveau prétendant à sa main doit négocier d'abord avec la femme et obtenir son consentement, avant de s'adresser à sa famille. Mais, dans les deux cas le choix matrimonial féminin demeure simplement passif, et la décision appartient malgré tout aux parents, qu'il est prudent pour une femme de ne jamais contrarier. Si elle agissait contre la volonté de ses parents, la femme se priverait de tout soutien en cas de rupture de son ménage; alors que l'homme peut au contraire risquer la rébellion contre la tutelle familiale sans trop graves conséquences, puisqu'il doit de toute manière gagner sa vie et devenir son propre maître.
Quoi qu'il en soit, le code islamique interdit à la femme toute alliance matrimoniale avec son fils, comme avec ceux de ses sœur et frère. Elle ne peut, d'autre part, avoir pour mari ledit frère, ni le frère de sa mère, encore moins le frère de son père, ou son propre père. Enfin, la femme ne pourra pas être unie au fils ou au père de son mari, cependant que le frère cadet de ce mari lui est autorisé en cas de veuvage (lévirat).
Le code islamique admet en conséquence l'union matrimoniale avec toute personne qui n'est pas apparentée au conjoint possible, selon l'un des degrés sus-mentionnés ; également à condition que les époux soient déjà de confession musulmane, ou en acceptent sans tarder et le baptême et les obligations rituelles. Quant à l'esclave — qui n'est en principe juridiquement reconnu par l'Islam que lorsqu'il n'est pas musulman, ou refuse la confession musulmane — il ne pourra prendre femme hors la catégorie servile que si auparavant il s'est dûment affranchi par rachat.
Les prohibitions matrimoniales informellement codifiées par la tradition prêtent exclusivement attention à l'appartenance de caste. L'expression yo ngundo res ngundo …, etc., nous est à cet égard devenue familière (cf. p. 77 supra). Mais, nous avons également aperçu combien la sévérité du principe est en piètre correspondance avec la réalité courante, certaines castes étant devenues par la force de l'habitude matrimonialement compatibles, les tooroBBe et seBBe, les seBBe et subalBe, les tooroBBe et FulBe, les wayilBe et maabuBe les sakkeeBe et lawBe, les wambaaBe et buurnaaBe, etc.
Quant aux préférences matrimoniales toucouleur elles sont nettement familiales, le mariage entre consanguins étant pour ainsi dire une règle sociale collectivement admise et appliquée. La faveur populaire pour le mariage consanguin sera couramment exprimée dans une sorte d'impératif 44 traduisible approximativement ainsi:
« Avant de défricher une terre étrangère féconde d'abord ta propre terre. »
Ainsi, dans la majorité des cas le Toucouleur prendra son épouse, soit dans la lignée de son père (gorol), soit dans celle de sa mère (dewol). Il semble qu'aucune préférence ne soit marquée pour l'une ou l'autre, toutes deux étant également privilégiées, encore que la fille de l'oncle — frère de la mère (Bi-kaaw) soit particulièrement recherchée. Mais, la fille du frère du père (Bi-baaba), celle de la sœur de la mère (remmeraaDo), et celle de la sœur du père (Bigorgol) bénéficient d'autant de faveur. Il n'y a donc pas de règle stricte quant au mariage préférentiel, s'il est en revanche certain que pour toute personne considérée, l'isolat est d'abord limité à son cercle familial consanguin et utérin. De ce point de vue, il est à peu près incontestable que les cousins épousent leurs cousines au degré le plus lointain, jusqu'au grand-père, voire l'arrière-grand-père patrilatéral comme matrilatéral.
Néanmoins, il est de fait que ces préférences matrimoniales ont acquis fort mauvaise réputation, à en juger par l'expérience commune, car dewgal ennDam hewaani Booyde — « le mariage entre consanguins est rarement durable ». En tout cas, si son rare succès est difficilement égalable, son échec trop fréquent ne surprend guère l'entourage, et c'est peut-être la raison de ces initiatives individuelles toujours plus nombreuses, consistant en une propension à prendre compagne hors du cercle familial. Ces conduites novatrices font à peine scandale, car l'on convient généralement volontiers qu'une femme étrangère à la famille de son mari n'a pas chance de trouver dans cette famille des alliés contre son mari. Elle doit, au contraire, s'y soumettre à la domination de tous par son mari interposé. Alors qu'une épouse, dont les parents sont également à des nuances près ceux de son mari se soumet avec plus de mauvaise grâce à l'autorité de celui-ci, qu'elle considère comme un pair (paso) tout juste supérieur par l'appartenance au sexe masculin. Autrement dit, ce que l'épouse « étrangère » sait admettre sans difficulté, la femme apparentée à son mari tendra à le réputer humiliant et intolérable, à cause de cette mentalité Binngu-baaba si habituelle entre conjoints issus d'une même famille.
Une autre caractéristique du mariage toucouleur concerne la dot (tenGe) et sa monétarisation désormais établie. Même si le bétail est encore régulièrement cité dans les démarches matrimoniales, c'est pour ainsi dire à titre de « repère », parce que la conversion est immédiatement opérée en somme d'argent. Le montant de cette somme est très variable, car il passe du minimum de 350 F C.F.A. requis de l'esclave, à 150.000 F C.F.A. et davantage selon les familles traditionnellement considérées comme illustres, et celles qui le sont devenues plus récemment. Il est de fait que la tendance est aux dépenses somptuaires qui frappent les esprits, et persuadent les conjoints comme leurs familles de la valeur exceptionnelle du mariage ainsi conclu, puisque « tout le monde en parle », singulièrement ces nyaamakala qui en sont toujours les plus grands bénéficiaires. Le mariage modeste est inacceptable pour la mariée et sa mère qui s'estimeraient frustrées et humiliées, en ne recevant pas le traitement habituel qui est en passe de se constituer en coutume, et consiste en une destruction toujours plus importante de biens.
Les temps sont donc révolus où le marabout brandissant son Koran et le cultivateur sa houe pouvaient obtenir une compagne sans bourse délier, parce que les vertus économiques de leurs instruments inspiraient d'emblée confiance.
Le mariage sans dot (dewgal sadak) n'a plus son sens d'humilité religieuse, car il est synonyme d'infamie pour l'un et l'autre conjoints comme pour leurs familles respectives.
Enfin, le mariage toucouleur est polygame, la polygamie étant comme l'idéal auquel chacun tend secrètement, parce que c'est une manière de se poser dans le monde pour obtenir considération. La polygamie permet aussi de créer des liens de parenté avec beaucoup de familles, sans compter la progéniture qui en procède et qui sera plus tard le soutien de son géniteur devenu vieux. Le sexe féminin est également consentant à cette clause, car il est bien entendu « préférable pour une femme de vivre dans un ménage polygame, plutôt que de végéter hors ménage ».
Néanmoins, la polygamie apparaît aujourd'hui plutôt limitée dans son extension sociale : il est sûr que la codification formelle de l'Islam trouve bien moins à s'appliquer que prévu et fixé officiellement, c'est-à-dire les quatre épouses et la concubine légales. C'est que les conditions économiques permettent à bien peu de personnes — à supposer qu'elles en aient encore le goût — de prendre en charge plus de deux épouses. Il semble que l'atavique polygamie toucouleur soit en train de devenir simple bigamie, laquelle est d'ailleurs assez souvent retransformée après concluante expérience en pacifique monogamie.
L'alliance matrimoniale en tant que telle équivaut à parenté de fait, bien que ce soit une parenté assez imprécise. En effet, quand l'alliance met en présence des personnes d'origine familiale distincte, on a l'habitude d'estimer que l'union matrimoniale vaut apparentement effectif (so yimBe ndesndiri ngonnti banndiraaBe). Et si l'alliance consacre simplement une parenté biologique initiale entre conjoints actuels, l'alliance est dite pérenniser concrètement la parenté (wuurtinnde lenyol), dans la mesure où les enfants à naître réalisent l'extension d'une lignée unique, celle-là précisément qui est déjà commune à leurs deux géniteurs.
L'alliance matrimoniale est par conséquent soit un point de départ, c'est-à-dire l'inauguration de la parenté effective entre non apparentés biologiques, soit une poursuite, donc la continuation indéfinie de la parenté effective déjà existante, et qui devient à chaque génération un peu plus inextricable./p>
Comment se présente alors cette parenté par alliance, autrement dit quelles sont les modalités des relations de chaque conjoint à la famille de l'autre conjoint, et en quoi consistent les termes classificatoires et les attitudes interpersonnelles ?
Le terme générique de la parenté par alliance matrimoniale est esiraagal, tout parent du mari sans distinction de sexe ou du degré de la parenté étant réputé esiraaDo, de l'épouse, et les parents de celle-ci esiraaBe de celui-là, tandis que chacun des conjoints est le BiDDo (bru ou gendre) de ses esiraaBe — beaux-parents. Toutefois, hors sa valeur sémantique générale de parenté par alliance, dans son sens précis et restreint esiraagal désigne plus spécialement la relation des géniteurs de l'un des conjoints à l'autre conjoint, par exemple les père et mère de la femme par opposition au mari de celle-ci. Mais, étant donné que les père et mère ne sont pas les seuls jinnaaBe du conjoint A, son conjoint B comptera d'autres esiraaBe. Ce sont, d'une part, les frères et soeurs, d'autre part, les BiBBe-baaba, denDiraaBe, remmeraaBe et giJiraaBe (des deux sexes) des géniteurs du conjoint A. Tous ces jinnaaBe — qui le sont soit directement (père et mère de A), soit indirectement en vertu de leur parenté ou rapport d'âge avec les père et mère de A — se trouvent globalement admis en qualité de esiraaBe relativement au conjoint B.
Nous conviendrons d'appeler le conjoint A du nom de Hammadi, dont l'épouse B recevra le nom de Sira. Les esiraaBe de celle-ci, c'est-à-dire ses jinnaaBe par alliance, ce sont tous les jinnaaBe effectifs de celui-là. En conséquence, il convient de distinguer deux catégories principales de esiraaBe selon le sexe, autrement dit les esiraaBe worBe (hommes), d'une part, et les esiraaBe rewBe (femmes), d'autre part.
Les principaux esiraaBe worBe de Sira se répartissent dans deux sous-catégories :
Les baabiraaBe par alliance de Sira sont les suivants :
En second lieu, les kaawiraaBe par alliance de Sira seront :
Quant aux principales esiraaBe rewBe de Sira — épouse de Hammadi — elles se rangent également dans deux sous-catégories :
Les yummiraaBe par alliance de Sira seront les suivantes :
Par ailleurs, les gorgolaaBe par alliance de Sira sont respectivement :
Tels sont essentiellement les jinnaaBe effectifs de Hammadi, et par voie de conséquence les principaux esiraaBe de Sira ; tandis que ces mêmes personnes considérées en tant que jinnaaBe effectifs de Sira deviendraient inversement les esiraaBe de Hammadi.
L'un quelconque des conjoints, que ce soit Sira ou Hammadi, adoptera généralement pour se situer vis-à-vis de tout esiraaDo considéré, le terme au moyen duquel s'exprime l'autre conjoint dans ses relations avec la personne concernée. Autrement dit, en chaque parent du conjoint A le conjoint B gagne un parent de même nature et réciproquement le conjoint A vis-à-vis des parents de B. Ainsi, les père, mère, oncle et tante demeurent tels pour leur gendre ou bru, dans le principe tout au moins et quand le gendre ou la bru s'adressent directement à eux.
Dans la réalité courante, lorsque l'un ou l'autre des conjoints parle de ses beaux-parents, il dit esam gorko et esam debbo, soit père et mère de mon conjoint, ceux-ci étant également baamum joom gallam et yummum joom gallam pour la bru 45, baamum joom suudam et yummum joom suudam pour le gendre, c'est-à-dire respectivement père et mère de mon mari, et père et mère de ma femme. Ces père et mère, parlant à leur gendre ou bru, emploieront simplement les anthroponymes usuels de ceux-ci, qui peuvent également devenir dans le discours de leurs beaux-parents joom suudu Byam — épouse de mon fils, et joom galle Byam — mari de ma fille.
En ce qui concerne les jinnaaBe secondaires, donc esiraaBe de même nature, ils sont, d'une part, kaaw mum joom suudam (oncle de ma femme), et gorgol mum joom suudam (tante de ma femme), d'autre part, kaawmum joom gallam (oncle de mon mari), et gorgol mum joom gallam (tante de mon mari). Pour sa part, l'oncle dira joom suudu baaDam (femme de mon neveu), et joom galle baaDam (mari de ma nièce), sinon joom galle (ou joom suudu) Bi-banndam debbo, à savoir mari (ou épouse) de l'enfant de ma sœur.
La tante se situera à l'endroit du gendre et de la bru de son frère dans les termes suivants : joom galle Byam ou joom galle Bi-banndam gorko (époux de ma fille, ou époux de la fille de mon frère), et joom suudu Byam, sinon joom suudu Bi-banndam gorko (femme de mon fils, ou femme du fils de mon frère)./p>
Tous les autres esiraaBe, c'est-à-dire les cousins et cousines des géniteurs, sont généralement assimilés aux frères et sœurs des géniteurs, et désignés par conséquent comme ces derniers. Cependant, l'éloignement de ces cousins et cousines relativement aux géniteurs de son conjoint peut parfois autoriser l'autre conjoint à une certaine familiarité, voire désinvolture à leur égard, ce qui lui permettra de les aborder simplement au moyen du terme esam ! beau-parent, sans préciser autrement le degré de la parenté par alliance.
Les attitudes sont très variables selon le beau-parent considéré ou bien selon le conjoint. A cet égard, la belle-mère est pratiquement sans commune mesure avec le beau-père, et leur différence s'accentue encore selon qu'ils ont affaire au gendre ou à la bru. L'on ne peut évidemment faire une étude approfondie d'un problème somme toute complexe, et si chargé de nuances quant aux relations personnelles et aux tempéraments individuels. Mais, l'on va néanmoins tenter de dégager quelques idées communes relatives à l'image sociale générale faite aux principaux protagonistes.
Au préalable, il convient de se demander quelles relations se tissent entre les parents des deux conjoints ? Il est clair que les parents de A ne sont pas esiraaBe des parents de B ni réciproquement. Par le mariage entre A et B, il se crée entre leurs parents respectifs une parenté assez mal définie: ils se trouvent simplement associés (banndiraagal), avec toutefois une nuance d'amour. « Aime ceux que ton enfant aime, et éprouve un sentiment similaire à l'endroit de tous ceux qui aiment ton enfant »: tel est le ciment essentiel des relations entre les parents respectifs des conjoints. Du moins, aussi longtemps que le lien matrimonial entre A et B n'est pas détérioré, car si l'union donne des signes de faiblesse ou bien si elle se rompt, chaque parent se range naturellement du côté de son enfant (jingannde banndum), même si les torts lui sont imputables. Ce qui a le don évident de transformer l'amour universel précédent en une hostilité généralisée entre les deux groupes, dont l'association aura été de courte durée. D'où cette réserve consécutive entre les familles devenues occasionnellement incompatibles, et qui de longtemps n'envisageront plus d'échange matrimonial. Sans doute, le conflit d'origine matrimoniale a parfois d'autres prolongements inattendus, et certaines oppositions apparemment mal fondées, mais irréductibles entre familles (Be kawrata) sont le plus souvent la conséquence lointaine d'une alliance jadis avortée, et demeurée indélébile dans la conscience des groupes, tout en attisant leur discorde illimitée.
Entre familles actuellement alliées les relations sont donc à l'image de l'alliance considérée, et épousent presque toujours son sort heureux ou malheureux.
De manière générale, la relation de n'importe lequel des deux conjoints à ses esiraaBe privilégiés (les géniteurs de l'autre conjoint) est d'abord faite d'une grande pudeur (kersa), ou refus obstiné de toute familiarité avec le beau-père comme avec la belle-mère.
Sans doute, la bru et sa belle-mère sont femmes, et le gendre et son beau-père des hommes : la communauté du sexe, c'est-à-dire une plus ou moins grande similitude de problèmes, peut faire que la glace soit rompue et que la familiarité s'instaure. Il n'empêche cependant que la réserve demeure une règle de relation entre le conjoint et son esiraaDo : celui-ci par sa seule présence peut assurer chez celui-là, fût-il réputé vulgaire et grossier, une auto-censure efficace de son langage et de son comportement. Le esiraaDo est un autre père ou une autre mère qu'il faut respecter en tant que tels, parce qu'il ne faut pas leur donner mauvaise opinion de soi et risquer de les voir rompre le ménage pour incompatibilité d'éducation, le conjoint de leur enfant étant si mal élevé (mo hersata esum). Au reste, l'individu socialement peu recommandable sera généralement défini par cette dernière expression, qui signifie « l'être impudique à l'égard de ses beaux-parents ». Le esiraaDo constitue en conséquence la barrière sociale ultime de l'absence de pudeur, et le parangon de l'impudeur c'est celui qui n'a cure de la présence de ses beaux-parents pour agir comme bon lui semble.
Outre sa pudique passivité, le conjoint doit marquer à ses esiraaBe une déférence soumise mais active, celui-là prêtant autant de services domestiques qu'il plaira à ceux-ci de requérir, voire avant que la demande soit formulée. Il faut savoir deviner les besoins de ses beaux-parents et les satisfaire incontinent, avant de songer à ceux de ses propres parents. Le conjoint n'oubliera pas de renouveler courtoisement son allégeance dévouée à ses esiraaBe, en allant chaque matin les trouver jusque dans leur case — après avoir quitté ses chaussures dès l'entrée de la concession — pour les saluer et prendre de leurs nouvelles, sinon s'inquiéter plusieurs fois dans la même journée de l'état de leur santé quand celle-ci est préoccupante. Ici encore l'on doit faire beaucoup plus pour ses esiraaBe que pour ses jinnaaBe : les seconds pardonnent facilement à leur enfant une négligence réparée, les premiers n'oublient jamais une erreur de leur bru ou gendre, sur le comportement desquels ils sont réputés excessivement chatouilleux. Les esiraaBe se formalisent à tout propos, étant toujours enclins à accuser le conjoint de leur enfant d'absence de considération (waasde teddinde). Que de conflits entre mari et femme ont pour origine précise l'affrontement entre esiraaBe tyranniques et gendre ou bru rebelle à leur domination !
La subordination du conjoint à ses esiraaBe est l'une des plus entières parmi les relations sociales de cette nature. Mais, elle concerne les deux esiraaBe privilégiés, à savoir les géniteurs de l'autre conjoint. Le degré de cette subordination ira donc s'amenuisant relativement aux esiraaBe secondaires, en fonction de leur parenté proche ou lointaine avec les deux beaux-parents, et en raison directe de leur grand âge ou de leur jeunesse relative, jusqu'à devenir une apparence ou un simple thème de plaisanterie. D'où la possibilité pour le conjoint de dire esam! tout en donnant une claque dans le dos à l'interlocuteur ainsi interpellé, conduite hautement scandaleuse à l'égard d'un esiraaDo stricto sensu.
Il est clair que la subordination est toujours plus forte pour la bru que pour le gendre, dans la mesure où celle-là est acquise à un nouveau foyer, où au surplus son maître est un dominé. Généralement, la bru est transférée au domicile de son mari où elle devra vivre sous les yeux de ses esiraaBe. Tandis qu'il subsiste tout de même une distance si infime qu'elle soit, entre un époux et les parents de sa femme, parce qu'ils ne partagent que très exceptionnellement la même demeure. De toute manière, la femme étant inférieure par définition sociale, il va de soi qu'en matière de subordination la plus grosse part lui incombe fatalement.
Tels apparaissent brièvement considérés les rapports généraux entre le couple matrimonial et ses beaux-parents correspondants, c'est-à-dire opposition polaire d'une certaine manière, le second pôle — en raison de son âge et de sa fonction parentale — obtenant la domination et la prééminence sur le premier, qui est corrélativement maintenu dans la réserve et la subordination.
Peut-être, n'est-il pas dénué d'intérêt d'esquisser les cas d'espèce, autrement dit la relation de l'un ou l'autre conjoint à chaque esiraaDo particulier, par exemple la belle-mère par rapport à son gendre ou sa bru, ou bien le beau-père dans des conditions identiques.
Le type social du beau-père, assurément moins tranché que celui de la belle-mère, est davantage conçu sur le mode favorable, la sentimentalité à son endroit étant sinon toujours positive tout au moins assez rarement répulsive.
C'est, en tout cas, ce qui apparaît concrètement dans la réalité courante. En effet, quand c'est sa fille qui est mariée, le beau-père transfère généralement l'essentiel de ses prérogatives à un gendre, dont il attend qu'il exerce effectivement l'autorité. Le beau-père est même assez souvent disposé à prêter main-forte à son gendre, pour obvier à tout manquement de la femme. Cette règle d'assistance constante du beau-père à son gendre, pour l'adaptation de l'épouse à son nouveau foyer, est socialement fondée sur la conviction qu'un ménage n'est durable que si la femme a toujours présente à l'esprit l'image d'un père sévère, qui non seulement ne composerait jamais avec sa fille mais encore lui donnerait toujours tort (debbo nde resoto ma jogo nehoowo). De sorte que le beau-père serait plutôt un appui pour son gendre, car il redoute dès l'abord la honte de voir sa fille en rupture de ménage, réputée insociable (resotaako) parce que mal élevée, ce dont la responsabilité lui est de toute manière imputée.
Le beau-père est donc assez souvent moralement bien disposé à l'égard de son gendre, tandis que matériellement il l'aidera, se refusant par exemple à constituer une charge pour le mari de sa fille (esiraaDo mo tampinnta). Le premier a donné au second une épouse exclusivement : par conséquent, il n'estime pas devoir transformer ce don en monnaie d'échange, pour en tirer un quelconque profit.
Tel serait donc le type social du beau-père, à tout le moins relativement à son gendre. Mais, assurément ce modèle admet de nombreuses déviations, dont les deux plus saillantes seront décrites. Il y a d'abord le beau-père à l'autorité intraitable (nyaDDo) et qui s'annexera d'emblée son gendre, tant au plan psychologique que matériel, parce qu'il le répute sans nuance son fils. Nul transfert d'autorité n'est donc consenti par le beau-père à son gendre, mais au contraire le premier entend rester seul juge et régler lui-même tous les conflits survenant dans le ménage du second, à la grande satisfaction de l'épouse, qui en appellera alors constamment à ce père si complaisant. C'est ici le gendre qui aura la plus grosse part des sermons, et subira l'autorité tyrannique de son esiraaDo gorko.
Il arrive aussi que le beau-père soit l'opposé du précédent, parce qu'il a abdiqué toute autorité entre les mains de sa propre femme (baawaaDo) dont il se comporte comme le jouet docile. La situation du gendre est alors plus tragique, car non seulement il n'y a nul bouclier à la toute-puissance de la belle-mère, mais encore le rempart habituel à cette toute-puissance devient offensif. Savamment conditionnée par sa fille, la belle-mère ira à son tour chapitrer dûment son faible mari; ce mouvement en chaîne aboutit forcément au gendre, qui en supporte entièrement les conséquences, son beau-père s'abattant sur lui avec toute cette violence habituellement comprimée par l'abdication maritale, qui trouve une excellente occasion pour se libérer.
Le modèle social de comportement du beau-père vis-à-vis de la bru se présente également en termes de soutien matériel et moral. L'épouse juvénile encore dépourvue d'expérience conjugale, n'étant pas de ce fait immédiatement adaptée à son jeune mari — également novice dans la vie matrimoniale — il ne sera pas rare que le père de ce dernier se charge de contrarier toute réaction inconsidérée de son fils, et avec d'autant plus de vigilance qu'il abrite le couple. Il se pose donc à la fois comme le conseiller de son fils et le protecteur de sa bru. Etant le père du mari, davantage encore il se considère comme père de l'épouse, dont il s'estime directement responsable. Il fera constamment pression sur son fils, pour que l'épouse de ce dernier — cette « fille d'autrui » (Bi-janano) — soit bien traitée dans son nouveau domicile (jogogal moJJal). Elle devra bien sûr être correctement logée, nourrie et habillée à la mesure des moyens dont dispose son époux, mais en aucune façon ses parents ne sauraient tolérer qu'elle subisse un quelconque sévice dans son ménage. A cet égard, le beau-père en tant que donataire direct de sa bru, lors de la célébration du mariage, s'est solennellement porté garant, vis-à-vis du donateur, du scrupuleux respect de l'intégrité physique et morale de la personne transférée sous son toit. Le beau-père ne se résoudra jamais à faillir à son serment : la bru sera inlassablement défendue contre le mari. Et le père de ce mari n'hésitera guère, quand cela devient indispensable, à entrer en conflit ouvert avec son fils pour exiger catégoriquement le divorce d'avec une femme que ce fils s'avère incapable de garder (sa wawa resde: seer, wata hoynu) 46. C'est qu'il y va de l'honneur de la belle-famille et surtout de son chef, en l'occurrence le père du jeune mari.
De manière identique à la position du gendre, il n'est guère douteux que le type social du beau-père, relativement à sa bru, doit subir toutes les altérations que lui imposent naturellement les tempéraments individuels. Car, il est évident que dans tout type de conduite sociale il faut d'abord faire leur place aux personnes qui se conforment à la règle prescrite ou en dévient. En outre, quelle que soit la définition sociale du beau-père, son attitude ne peut manquer de refléter fidèlement la situation interne du couple matrimonial, dont il tient précisément son titre de parent par alliance. Autrement dit, l'attitude du beau-père ne saurait être identique quand le couple est en harmonie, et quand il est en situation conflictuelle.
En tout état de cause, et sauf exception inhérente soit à la situation intérieure du ménage, soit au tempérament particulier de la personne, le beau-père est l'être généralement estimé tant par sa bru que par 'son gendre, à cause de son rôle de soutien moral et matériel du couple. Le beau-père est pour ainsi dire une personnalité assez rarement honnie dans la société globale.
La belle-mère est certainement aux antipodes de son mari, car elle est socialement définie comme mauvaise par nature (warkas esiraaDo debbo ! — esiraaDo debbo waDaaka barke !). C'est la raison pour laquelle spontanément le gendre comme la bru la maudissent à l'envi, allant jusqu'à souhaiter sa mort, afin d'en être libérés. Très souvent du reste, la belle-mère a une place de choix parmi les ennemis apparents et réels, humains comme surnaturels, ennemis que toute personne compte par le seul fait de son existence individuelle, et contre lesquels il est coutumier de se prémunir chaque matin lors de la prière d'entrée du jour (yallah danndam e anyBam e esam debbo !) .
L'unanimité de cette affectivité négative confinant à la répulsion serait probablement imputable au fait que la belle-mère est toujours Intimement liée au ménage, lorsqu'il s'agit de son fils comme de sa fille. Tandis que le beau-père est quelque peu détaché de la vie quotidienne du ménage de n'importe lequel de ses enfants, n'y intervenant qu'en cas de nécessité — l'image favorable du beau-père est issue de ce détachement — la belle-mère, en revanche, est chroniquement présente dans l'existence du couple matrimonial, et trop souvent de manière intempestive au gré des époux.
Soumise ou non à son mari, la belle-mère est bien décidée à être vengée de son infériorité congénitale par sa fille, à laquelle les conseils ne manqueront jamais sur la (mauvaise) manière d'amener son époux à résipiscence, pour ne point se laisser domestiquer par lui. Il est certain que la fille écoute attentivement sa mère, qui est une épouse de longtemps expérimentée : pour acquérir le savoir accumulé par celle-ci, celle-là appliquera fidèlement les préceptes et directives qui lui dont donnés avec tant de constance, et sous le sceau du secret. De toute manière, la mère se fait toujours très difficilement à l'idée d'une séparation définitive d'avec sa fille, qui lui est si solidement attachée depuis la naissance. Cette fille étant mariée, la mère va tout mettre en œuvre pour maintenir sa domination, sinon susciter dans le ménage assez de difficultés pour en rendre inévitable la dislocation. A cet égard, tout se passe comme si la mère voulait reprendre sa fille et la ramener à la maison. Peut-être parce que la fille, nantie de cette responsabilité exaltante qui lui incombe comme épouse, inclinerait assez rapidement à secouer la tutelle de sa mère, ne voyant plus en elle qu'une congénère quelconque, astreinte aux mêmes besognes conjugales et à une soumission identique. Or, la mère n'admet jamais semblable identification avec sa fille, qui doit rester perpétuellement sous sa domination quoi qu'il advienne. Et c'est probablement la raison pour laquelle la belle-mère est spontanément hostile à son gendre, celui-ci apparaissant comme l'être qui a arraché la fille à la domination maternelle, et privé cette mère de l'aide domestique qu'elle obtenait.
Il est d'ailleurs fort significatif qu'en dépit du mariage de la fille, sa mère continue d'exiger d'elle l'habituelle prestation de service, si difficilement compatible cependant avec la situation nouvelle. Ce sont alors des tiraillements sans fin entre la mère de plus en plus exigeante, la fille mariée qui n'en peut mais, et le gendre sidéré puis indigné, auquel l'inévitable belle-mère n'arrête pas de faire payer quotidiennement pour ainsi dire et très chèrement son mariage. Tout se passe évidemment à l'insu complète du beau-père qui n'admettrait guère cette manière de procéder. Mais le beau-père est bien souvent tenu dans l'ignorance des convulsions familiales de cette nature, les trois protagonistes semblant généralement d'accord pour faire là-dessus la conspiration du silence. Ainsi, la belle-mère est à peu près sûre de son fait, car ce n'est évidemment pas sa fille qui va la trahir, encore moins son gendre, celui-ci ne tenant nullement à perdre l'estime de son beau-père, et à passer à ses yeux pour un délateur (denndinoowo).
Néanmoins, l'érosion lente mais implacable opérée par la belle-mère sur le ménage de son gendre rend inévitable la rébellion de celui-ci, et la rupture de l'union. A moins que le gendre lassé et soumis ne finisse par s'accommoder des prétentions de sa belle-mère, en lui abandonnant entièrement la tutelle qu'elle tient à conserver sur sa fille.
La belle-mère est donc l'adversaire déclaré de son gendre, parce qu'elle constitue bien souvent un sérieux obstacle dans le ménage de sa fille. Mais la belle-mère s'oppose tout aussi farouchement au ménage de son fils, et s'entend rarement avec sa bru (esiraaDo debbo na haDa reseede e resde). Elle peut être jalouse de cette bru qu'elle traite de la même manière qu'une coépouse (nawliraaDo). C'est par conséquent dire que la mère exigera souvent de son fils un entretien identique sinon supérieur à celui qu'il consent à sa femme. En outre, la belle-mère tend à se dessaisir systématiquement de tout labeur domestique à compter du jour où son fils lui donne une bru. Celle-ci sera rapidement transformée par sa belle-mère en une servante complète, qui ne devra jamais s'aviser de regimber. Car l'issue de tout conflit entre belle-mère et bru, c'est fatalement là correction exemplaire de la bru voire sa répudiation immédiate par le mari, qui prend spontanément fait et cause pour sa mère outragée. Il va en effet de soi que le principe directeur de la justice familiale est que la mère ne saurait avoir tort en cas de conflit avec la bru, qui est d'emblée son inférieure (yummiraaDo fonndetaake e joom suudu).
Il est néanmoins certain que dans la relation de la belle-mère avec son gendre ou sa bru l'on rencontre encore des déviations eu égard au type social de conduite. L'entente effective entre belle-mère et bru voire leur amitié, comme l'estime durable ou la confiance réciproque entre esiraaDo et gendre ne sont pas vraiment exclues. Cependant, ces dernières situations seront pour ainsi dire exceptionnelles, l'entourage médusé ou sceptique n'y voyant généralement que de simples supercheries, éphémères (Booyata) par surcroît.
L'on a précédemment vu que chacun des deux individus formant le couple matrimonial admettait pour esiraaBe la totalité des jinnaaBe de son conjoint, sans distinction relative au sexe du conjoint ni au jinnaaDo de référence.
Il en ira différemment dans la fraternité par alliance, où la terminologie sera au contraire double : l'on dira keyniraaBe en considération du mari, et JeekiraaBe en ce qui concerne la femme.
Quel contenu est habituellement donné à ces dénominations de la fraternité par alliance ?
1. Keyniraagal. — L'époux de ma sœur, le frère et la sœur de ma femme, tels sont les keyniraaBe par définition. Car le keyniraagal n'est autre que cette fraternité immédiatement créée entre l'homme marié et la totalité des frères et sœurs de son épouse. Les frères et sœurs de Sira sont donc les keyniraaBe de son mari Hammadi, qui est réciproquement le keyniraaDo beau-frère de chacun d'entre eux.
Lorsqu'il s'adresse personnellement au beau-frère (ou belle-soeur), le mari emploie l'anthroponyme de son interlocuteur, et réciproquement de celui-ci à celui-là. En revanche, quand ils parlent les uns des autres, outre keynam gorko (mon beau-frère) ou keynam debbo (ma belle-soeur), les keyniraaBe disposent de beaucoup d'autres expressions, C'est ainsi que Hammadi appellera les cousins et frères de Sira : wanndiraaBe worBe joom suudam — les frères et cousins de ma femme, tandis que les sœurs et cousines de Sira seront mawniraaBe le minyiraaBe joom suudam. Inversement, Hammadi sera pour les premiers joom galle bannden debbo — mari de notre cousine ou sœur, et pour les secondes soit familièrement joom galle men notre mari, soit joom galle (minyen ou mawnen) — mari de notre sœur (cadette ou aînée). Par ailleurs, il n'est pas tout à fait exclu que les keyniraaBe, surtout quand ils sont déjà biologiquement apparentés, se situent vis-à-vis les uns des autres au moyen des termes allusifs à l'âge, tels deede (aîné), et minyel (cadet). Dans ce cas, les keyniraaBe excluent en apparence leur parenté par alliance, pour s'en tenir plutôt aux liens existant antérieurement à cette alliance.
Deux groupes de keyniraaBe sont à distinguer selon le sexe :
Si le mari de la sœur de Sira est bien un beau-frère pour Hammadi, il n'est peut-être pas tout à fait keyniraaDo. Et quand par ailleurs pour ce qui concerne Hammadi, la sœur de Sira a droit à l'appellation de keyniraaDo, le mari de cette sœur est dit joom galle keyniraaDo — époux de belle-sœur. C'est probablement une simple distinction terminologique, car tous les époux de keyniraaBe rewBe et, partant, toutes les épouses de keyniraaBe worBe, sont des keyniraaBe de fait.
2. Jeekiraagal. — Tout ce qui concerne le keyniraagal peut être rapporté mutatis mutandis dans le Jeekiraagal, car il y a simple changement de perspective. En effet, aux lieu et place du mari c'est la femme qui est ici la personne de référence. Les frères, sœurs, cousins, cousines et camarades d'âge de Hammadi forment l'ensemble des jeekiraaBe de Sira, qui est par réciprocité le JeekiraaDo de chacun d'eux.
Sira appellera chaque JeekiraaDo par son nom, et elle sera Sira pour tous, tandis que de part et d'autre l'on dira Jeekam gorko (mon beau-frère) ou Jeekam debbo (ma belle-sœur), en parlant de la personne. Toutefois, il s'ajoute à ce Jeekam une foule d'expressions distinctes. Sira appellera familièrement chacun des frères et cousins de son époux joom gallam — mon mari, et moins familièrement mawnum ou minyum joom gallam — frère aîné ou cadet de mon mari. Dans des conditions identiques, Sira sera pour les précédents, respectivement joom suudam (mon épouse), et joom suudu (mawnam ou minyam) — épouse de mon frère (aîné ou cadet). Relativement aux soeur et cousine de son mari Sira devient joom suudu banndam gorko — épouse de mon frère, tandis qu'elle dit banndum debbo joom gallam — sœur de mon mari. Plus spécialement, l'épouse du frère sibling de Hammadi sera pour Sira et réciproquement peceero (pl. fesiraaBe). Les épouses de frères siblings, en effet, sont considérées les unes relativement aux autres moins comme simples alliées que comme des soeurs véritables (fesiraagal), en raison de la fraternité existant entre leurs maris. Toutefois, les relations réciproques des fesiraaBe ne sont pas fatalement exemptes d'hostilité et de jalousie. Il arrive bien souvent même que ces femmes se situent l'une vis-à-vis de l'autre comme si elles étaient des co-épouses d'un seul homme, ce qui peut au demeurant leur échoir dans le lévirat, à la suite du décès de l'un des frères. En tout état de cause, l'hostilité entre fesiraaBe sera d'autant plus apparente que la situation économique ou sociale de leurs époux respectifs sera différente : la femme privilégiée tendra à mépriser ses fesiraaBe moins bien loties, tout en essayant de dresser une barrière entre son mari et les propres frères de celui-ci.Les rapports spéciaux entre keyniraaBe ou JeekiraaBe ne sont pas aussi tranchés que les relations esiraaBe — BiBBe. En effet, au lieu des deux générations affrontées dans le esiraagal (filiation), le keyniraagal ou Jeekiraagal est un rapport de même niveau au sein d'une seule génération, rapport de simple fraternité en dépit des notables différences d'âge pouvant exister entre beaux-frères et belles-sœurs.
Il y aura par conséquent beaucoup moins de tension entre keyniraaBe, parce que la notion de respect et d'égard sera plus diffuse. Sans doute, un keyniraaDo peut être très largement l'aîné du mari de sa sœur, mais sans acquérir pour autant de son beau-frère cette subordination méritée d'abord par les seuls jinnaaBe. En revanche, il obtient effectivement la considération à laquelle son âge lui donne droit, car nous savons l'âge au nombre des valeurs sociales, et le pouvoir de domination qui en est issu et qui s'exerce sur l'ensemble des cadets.
La familiarité n'est ni complètement exclue des relations entre keyniraaBe ou JeekiraaBe, ni une règle de comportement à l'intérieur de ces relations. Il est certain que la similitude de sexe, d'une part, et la communauté de classe d'âge, d'autre part, facilitent largement la familiarité entre les beaux-frères et belles-sœurs. Mais, il semble cependant que cette familiarité éventuelle doive connaître une limite, ne pouvant être complètement expurgée de la pudeur qui, après tout, est la caractéristique dominante de la parenté par alliance. Tel semblerait probablement être le sort inévitable des relations amicales entre deux jeunes gens, antérieurement à l'union de l'un avec la sœur de l'autre : cette union postérieure à leur relation d'amitié est souvent l'occasion d'un sentiment corrélatif de pudeur (kersa), et progressivement d'une certaine réserve entre les deux amis (sehilaaBe ou musiDaaBe) et nouveaux beaux-frères, réduisant à coup sûr leur fréquentation et leur familiarité de jadis.
En tout état de cause, étant donné que l'alliance matrimoniale admet naturellement la domination de la femme par l'homme et non leur égalité, il y aura des différences d'attitudes et de comportement selon le Jeekiraagal ou bien le keyniraagal. Dimorphisme pour ainsi dire des relations entre JeekiraaBe et des relations entre keyniraaBe : les « devoirs » de la femme vis-à-vis de ses JeekiraaBe seront sans commune mesure avec ceux, presque nuls, de l'homme vis-à-vis de ses keyniraaBe. Ainsi, la femme est contrainte à quelque allégeance, à l'égard de tous ses beaux-frères et belles-sœurs, parce qu'elle est acquise à leur famille et doit s'y faire accepter. Il lui faut donc y nouer des alliances sûres auprès des personnes les plus proches de son mari par la génération, capter leur confiance pour qu'elles témoignent en sa faveur, le cas échéant, et s'opposent éventuellement à sa répudiation. L'épouse s'adressera à ces mêmes personnes pour se plaindre de son mari et obtenir leur soutien contre lui, ou bien pour leur faire appuyer une quelconque requête qu'elle hésite à présenter au mari. C'est pourquoi la femme ménage rarement sa force pour rendre service aux JeekiraaBe des deux sexes. Il est vrai que la capacité de travail d'une femme appartient à toute la famille du mari. Et il n'est nullement besoin qu'intervienne le mari pour que la femme, préalablement éduquée dans cette perspective et qui a parfaitement assimilé son rôle, devance le besoin de son JeekiraaDo, durant tout le temps nécessaire et jusqu'à ce que celui-ci s'installe en ménage à son tour. En outre, tout ce qu'il est décent de partager appartient à tout le monde : tel est le sort de la femme « propriété » collective de la famille de son mari, ce dernier ne se voyant reconnaître, tout au moins en droit, que l'exclusivité des relations intimes. En réalité ce qui est primaire c'est la situation d'infériorité sociale de la femme, ensuite seulement intervient sa soumission à sa belle-famille, d'autant qu'elle vit en son sein et s'y trouve plus facilement à la disposition de tous.
Et si à la suite d'une difficulté dans son ménage l'épouse abandonne ce nouveau domicile pour réintégrer celui de ses parents (cuutungu), le devoir de l'un de ses frères est de l'y ramener de gré ou de force pour se laver de tout soupçon d'encourager semblable esprit d'indépendance, qui est un grave manquement à la soumission conjugale exigée de la femme, quels que soient ses griefs contre son mari.
Sans doute, le keyniraaDo du mari peut refuser cette « humiliation » pour lui et sa sœur, abandonnant alors à l'époux, au frère de cet époux, voire à son meilleur ami le soin de la réconciliation. Mais, à la suite de cette attitude de refus, l'on estime généralement que le frère de la femme s'est soustrait au principal devoir de keyniraaDo, qui consiste à montrer le droit chemin à sa soeur.
Notes
1. Le sens exact de kelti nofel ne semble pas avoir été conservé. Sans doute nofel (oreillette) est un diminutif pour nofru (oreille) et kelti pourrait suggérer keltine (brisures) : l'on hasardera, avec beaucoup de réserves, que kelti nofel serait l'indication d'une usure complète — surdité comprise — du très grand vieillard auquel l'expression s'applique.
2. C'est une expression rarement employée, à cause de la nuance passablement péjorative que peut lui donner une certaine intonation. Il en irait semblablement de keltaati nofel qui est le prédécesseur de kelti nofel.
3. Les griots généalogistes passent encore non sans quelque raison pour les gardiens de l'histoire traditionnelle, dont ils sont obligés de se souvenir parce qu'elle constitue la principale source de leurs revenus. Les griots actuels sont toutefois des falsificateurs, du moins en ce qui concerne la grande majorité : ils débiteront souvent n'importe quelle généalogie imaginaire pour celer leur ignorance, quand ce n'est pas plus simplement pour exploiter la vanité de leur auditeur-client.
4. C'est la manière habituelle — imagée et grossissante — d'évoquer maints héros toucouleur d'antan. Les griots généalogistes affectionnent particulièrement cette méthode éprouvée, parce qu'elle suscite incontinent la fierté des descendants, et leur générosité à proportion. Ce couplet, que l'on a transcrit à titre d'exemple, vise Ibra Jaatara Aany (Agne) de Gaawol (Gaol) Ngenaar, qui fut concurremment Almaami du Fouta et Elfekki du Ngenaar, parce que savant en Islam.
5. Il est à remarquer que BiDDo (enfant) n'entre pas dans la composition de taaniraagel (petit-enfant) ou dans celle de njaatiraagel (arrière-petit-enfant), tous deux ayant même radical que le parent correspondant, taaniraaDo et njaatiraaDo.
6. L'époux se dira indifféremment « homme » (gorko, pl. worBe) ou « maître de maison » (joom galle) placé devant le nom de l'épouse correspondante : gorko Kumba ; joom galle Kumba. Inversement, cette dernière sera « femme » (debbo, pl. rewBe) ou « maîtresse de la case » (joom suudu) de tel homme, sinon gen, ou encore cuddiiDo (pl. suddiiBe) précédant le nom du mari, cette quatrième forme de « madame » signifiant « la personne voilée », par conséquent de sexe féminin.
7. Par aînés et cadets, il faut constamment entendre les deux classes d'âge immédiatement supérieure et inférieure (pelle dow e les).
8 Il est de pratique fréquente d'interdire à l'arrière-petit enfant de toucher l'oreille de son arrière-grand parent, sous peine de condamner ce dernier à une mort rapide.
9. Il en va de l'estimation abusive (haawtaade) du nombre des personnes, comme de la vantardise (wasaade) concernant les biens que l'on possède : c'est se condamner pratiquement à les perdre comme par le fait d'une loi surnaturelle d'équilibre, qui aurait le pouvoir de ramener à une moindre quantité tout ce qui est présenté par la parole ou la pensée comme étant en trop grande quantité.
10. Le sevrage intervient généralement à compter du douzième mois de l'enfant, et avant sa deuxième année révolue. L'allaitement excessif par sa durée étant d'une certaine manière considérée comme susceptible de tarer l'enfant (mbaaddi), il est bien rare qu'il soit prolongé au-delà de cet âge, sans compter qu'une nouvelle grossesse de la mère contraindra souvent à interrompre l'allaitement avant le vingt-quatrième mois.
Le sevrage comme le baptême impliquent l'intervention du marabout (ceerno). Celui-ci imprègne de sa salive — sacralisée par la récitation d'un verset approprié — la nourriture qui sera désormais celle de l'enfant. Cette nourriture symbolisée par un gâteau de mil, d'où l'expression : o watti nyaamde gawri — vivre de mil, qui désigne l'enfant sevré. La préparation du marabout est à plus ou moins brève échéance — entre 3 et 8 jours — censée pouvoir détourner l'enfant du soin maternel, d'autant plus radicalement que le tétin s'en trouve à cette occasion enduit de bouse de vache ou de piment...
11. Gifles de grand-parent.
12. Respectivement enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
13. SawndiiBe (pl. de cawndiiDo) signifie littéralement « placés de front » ou « parallèles ».
14. Kane (I.), « La circoncision chez les toucouleurs », Dakar, L'Education africaine, Bull. E. A.O.F., n° 96, 1937, p. 42-47.
15. La coutume est encore appliquée qui consiste pour la mère biologique à confier sa fille aux soins d'une mère sociale : soeur de cette mère physique, cousine, amie, voire simple alliée. C'est pour ainsi dire une adoption définitive également pratiquée d'homme à homme, car un père peut dans la pleine acception du terme donner l'un de ses enfants à son frère ou cousin sans progéniture. Le père et la mère adoptifs deviennent les parents effectifs de l'enfant, avec l'accord complet des parents biologiques entièrement dessaisis. Désormais l'enfant sera à la charge unique de ses parents adoptifs jusqu'à son mariage, qui sera également de leur ressort exclusif. C'est pourquoi il s'assimile entièrement à son nouveau foyer, et devenant adulte continue de nommer père et mère non point ses géniteurs vivants, mais ceux qui en ont socialement assumé les rôles à son endroit.
Dans le cas particulier de la fille élevée par une mère sociale, il semble que la relation avec la mère physique subisse quelque détérioration. S'il est hasardeux de parler de transfert, voici en tout cas trois propos relevés chez des femmes adultes qui ont précisément vécu cette situation d'adoption :
— « Je refuse d'obéir à celle qui m'a enfantée (neenam jibinnDo mi) parce qu'elle n'a jamais été ma mère. »
— « Elle (neenam jibinnDomi) m'a donnée parce qu'elle ne m'aimait pas, et j'ai été recueillie telle une orpheline. »
— « Elle (neenam jibinnDomi) ne connaît rien à ma situation ni à mon caractère (jikkam): comment pourrait-elle me comprendre ? »
Ce sont des cas extrêmes probablement, mais il n'est pas douteux que cette forme d'adoption se traduise pour le moins par l'indifférence de l'enfant à l'égard de ses géniteurs propres, devenus d'une certaine manière anonymes.
16. C'est ce que l'on pourrait appeler l'option matrimoniale prénatale, moyennant quoi une femme peut manifester le désir de voir son fils allié à la fille née ou à naître de telle autre femme appréciée, parente ou amie. La première femme symbolise le futur lien matrimonial au moyen d'un bout de chiffon noué ( haBBude tekkere) en parole ou en acte, à la cheville de l'optée. Toutefois, ni celle-ci devenue grande, ni sa famille ne sont engagées véritablement par ce geste, pas plus d'ailleurs que le garçon et sa famille.
17. En fait, pour s'exprimer l'on doit soigneusement éviter de faire état du lien matrimonial concernant un jinnaaDo (plus rarement le taaniraaDo, en raison de la relation de plaisanteries), sous peine de proférer un blasphème. La femme du père, autre que la mère, c'est littéralement debbo baabam, et joom galle neenam le mari de la mère, autre que le père. De même, joom galle gorgolam, pour le mari de la sœur du père, et debbo kaawam, pour l'épouse de l'oncle. Ces quatre expressions deviennent respectivement gorgol, kaaw, kaaw et gorgol, par assimilation des personnes, donc par obéissance à la règle informelle obligeant les BiBBe à feindre d'ignorer le mariage de leurs jinnaaBe, mariage qui dépasse leur (bouche) entendement (diwti hunuko).
18. Lorsque ledit époux est le frère réel ou classificatoire du père de l'enfant (lévirat), il s'agit simplement d'un second père. Tandis que si cet époux est étranger à la famille du père, il sera plutôt l'oncle de l'enfant, lequel n'est pas son neveu-baaDiraaDo mais son jinnaaDo, c'est-à-dire beau-fils ou belle-fille, sinon Bi-debbam, à savoir « enfant (du premier lit) de ma femme ».
19. En réalité, ce pouvoir bénéfique de l'oncle dans l'univers extra-terrestre apparaît comme l'antidote du pouvoir terrestre reconnu aux deux géniteurs, d'appeler la malédiction — et d'être entendus du Ciel — sur leur enfant coupable de faute très grave, comme de porter la main sur sa propre mère (fiide yummum) ou d'abandonner systématiquement ses parents dans le dénuement (haGGe jinnaaBe). L'oncle constitue donc un rempart ultime contre la redoutable malédiction des géniteurs (kuddi jinnaaBe). La malédiction avunculaire est évidemment beaucoup plus grave, étant tout simplement irrémédiable.
20. Naturellement, à la condition que l'enfant de — cette première épouse soit le plus âgé de tous les autres enfants vivants du père, la qualité d'aîné ne faisant acception que du seul âge, et non de l'ordre d'arrivée des femmes dans le ménage polygame.
21. Attié (Y.), « Un baptême chez les Toucouleurs », Dakar, I.F.A.N., N.A., n° 16, 1942, p. 9-10 ; Wane (Y.), « Sur une forme de solidarité. Le baptême toucouleur », Dakar, I.F.A.N., N.A., n° 98, 1963, p. 42-46.
L'on peut envisager l'imposition du nom à l'enfant comme rite d'entrée dans la vie concernant un individu encore asexué ; de la même manière, circoncision et clitoridectomie constituent des rites d'entrée dans les catégories masculine et féminine, le deuil apparaissant alors comme rite de sortie de la vie.
L'imposition du nom ou rite d'entrée dans la vie est caractérisée par les trois faits suivants, qui concourent au même résultat de bénédiction (duhahu), pour honorer et maintenir la vie de l'enfant. Il y a d'abord le rasage du nouveau-né par sa gorgol (tante patrilatérale) : les cheveux sont posés et le père fait aux pauvres l'aumône de l'équivalent en or (converti en numéraire) du poids de ces cheveux, lesquels sont ensachés dans un gris-gris que l'on fait porter à l'enfant. D'où une première bénédiction dite par les bénéficiaires de l'offrande.
Ensuite un animal est immolé et à l'issue de ce sacrifice le nom choisi est révélé à la cantonade. L'assistance répète ce nom en souhaitant à son nouveau porteur qu'il soit ce nom, c'est-à-dire vive et prospère : d'où une nouvelle bénédiction. Toutefois, il faut signaler que le seul animal admis au baptême est le mouton d'un certain poil, d'au moins douze mois révolus et non taré physiquement. Tout autre animal serait impropre à l'imposition du nom, la chèvre singulièrement, parce qu'elle ferait de l'enfant un bavard insupportable.
Enfin, intervient la bénédiction directe avec imposition des mains notamment. Après le marabout qui a baptisé et à la suite du père de l'enfant, chaque membre de l'assistance doit se muer en bénisseur et caresser à son tour la tête du nouveau-né, puis lui souffler son souhait personnel de vie et prospérité dans le conduit de l'oreille droite et dans la bouche, qui passent également pour voies propices.
22. Yettoode ou yettoore pourrait traduire, soit moyen de reconnaissance, et d'approche (yettaade neDDo, c'est-à-dire faire une visite à telle personne pour la saluer), soit moyen de louange et flatterie (yettude neDDo, à savoir rendre publics ses bienfaits et qualités). Cf. Gaden (H.), Du nom chez les Toucouleurs et Peuls islamisés du Sénégal, Paris, 1912, passim ; et du même autour, Proverbes et maximes peuls et toucouleurs, Paris, 1931, passim.
23. Leriche (A.), « Anthroponymie toucouleur », Dakar, Bull. I.F.A.N., série B, t. XVIII, 1956, p. 169-188; Gaden (H.), « Du nom chez les Toucouleurs et les Peuls islamisés du Fouta sénégalais », Paris, Leroux, Revue d'ethnographie et sociologie, 1912, p. 50-56.
24. Suivant ses moyens, le parrain ou la marraine (ginniraaDo BiDDo) prend matériellement le baptême de l'enfant à sa charge, ou bien se signale en cette circonstance par un cadeau exceptionnel. C'est une dignité qu'il faut mériter, mais dignité redoutable, car bon ou mauvais l'avenir de l'enfant est d'une certaine manière censé dépendre de la « valeur » personnelle du parrain choisi.
25. A moins que ce ne soit plutôt la nostalgie de cette souffrance qui attache la mère au cadet de ses enfants, s'il faut en croire la psychanalyse.
26. La conséquence de cette croyance est que le baptême des jumeaux intervient le septième jour suivant l'accouchement du dernier mais non du premier d'entre eux.
27. La grossièreté suprême consiste précisément à s'en prendre aux ascendants de l'interlocuteur, particulièrement à sa mère. Celui qui injurie nommera les parties sexuelles des géniteurs de l'adversaire, sinon il impliquera la mère de l'injurié dans un rapport sexuel où il se réserve l'autre rôle.
L'injure (Jattoore) est d'une certaine manière désacralisation publique des jinnaaBe: la victime d'une semblable agression de la parole étant comme déshonorée, il n'est pas rare qu'elle mette sa vie en question pour laver l'affront. Selon les tempéraments l'on aura affaire, soit à la riposte verbale ou gestuelle, soit à l'absence de réaction, cette dernière attitude étant celle du lâche, sinon celle du croyant qui a le blasphème en horreur, et reste persuadé de l'existence d'une justice immanente (mi Daccidiima e Allah).
Il convient de noter que l'avènement du dogmatisme politique a fait de l'injure une arme courante et banale, abondamment utilisée au cours de ces affrontements électoraux, mettant aux prises des factions irréductiblement ennemies. Il est vrai qu'il s'agit plutôt de simples affrontements de personnes mais nullement de confrontations doctrinales.
28. L'ordre de naissance contient une autre signification, en ce sens qu'on lui prête le pouvoir d'accorder ou de refuser à J'enfant certaines qualités physiques et mentales bien définies. C'est ainsi que l'aîné absolu (Hammadi ou Sira), et le troisième enfant (Demba ou Penda), seraient couramment réputés sans beauté mais encore lymphatiques et dépourvus de finesse intellectuelle. Au contraire, le deuxième enfant de même sexe que son aîné absolu (Samba ou Kumba) serait un paragon d'intelligence, et se manifesterait très jeune par la ruse, la vivacité et la bonne humeur, dans les mêmes conditions que le cadet absolu.
Par ailleurs, et quel que soit son rang de naissance, l'enfant né de père très âgé (Bi-nayeejo) serait pondéré et fort expérimenté, à l'image même de son géniteur.
29. Il faut signaler la quasi-fraternité entre personnes appartenant généralement à des castes différentes, donc étrangères sur le plan familial. C'est le cattidiigal dont les tenants, ceDDo-sakke, tooroodo-maccuDo, ou tooroodo-ceDDo, etc., sont sattidiiBe, presque frères siblings. Différent de la relation d'âge (fedde), le cattidiigal procède d'une très ancienne cohabitation (koddiigal ou gonndiigal) des ascendants transmise aux descendants successifs. Dans la relation de cattidiigal la notion de caste est souvent abolie, du moins sous l'aspect revendicatif du nyeenyo à l'égard du dimo devenus frères communautaires. En outre, les sattidiiBe sont toujours de grands amis (sehilaaBe) et se font denDiraaBe parfois. L'on affirme aussi que dans le vrai cattidiigal entre familles, à chaque décès enregistré dans l'une correspondrait simultanément ou à bref délai un décès dans l'autre, et réciproquement.
30. Est soowoore (pl. coowooje) tout mot ou expression servant à nommer une personne à l'exclusion de son anthroponyme propre. Le soowoore pourra être allusif :
Le soowoore sera en outre indicatif de la caste d'appartenance: jaawanDo (sooma), ceDDo (jagaraf), cubballo (jaaltaaBe). Enfin, le soowoore marquera le respect dû à telle personne assimilée à un jinnaaDo en raison de son âge, comme baaba appliqué à un homme quelconque.
31. Selon des observations conduites en milieu africain urbanisé par le Dr S. Faladé, le devenir de l'aîné — succès ou échec social — commanderait souvent celui du cadet, parce que le second tendrait à se conformer à l'exemple que lui donne le premier. Telle est bien l'émulation du Binngu-baaba.
32. Egalement par le voisinage géographique, comme entre les ressortissants du Boseya et ceux des YirlaaBe, provinces dont les chefs-lieux respectifs sont Cilony et Salde (Tebegut). Est-ce de ce cousinage interprovincial que procède la réputation de fourberie du Boseyaajo, ou natif du Boseya ? En tout cas, pour n'importe quel Toucouleur, Boseyaajo est synonyme de traître fatal.
33. Le sacrifice de soi est le lot bien compris de tout aîné à l'égard du cadet : lorsqu'il y a lieu de partager entre eux, il est de coutume que le second se serve en premier lieu (ko cukolel laboto).
34. Nous avons déjà rencontré cette légende (p. 62 supra) à l'occasion de la genèse des griots généalogistes (awluBe) : le cadet, sauvé de la mort ou de l'esclavage par l'aîné, consacre le reste de son existence à chanter les louanges de son sauveur.
Il est en tout cas clair que le sacrifice décrit par cette légende est d'une certaine manière la forme la plus achevée de ce pacte du sang, lequel est considéré comme la première origine de la parenté à plaisanteries.
35. Selon une hypothèse également répandue, les Toucouleur et les SereraaBe sont des cousins à plaisanteries, parce qu'ils ont d'abord été des cousins croisés, par conséquent originaires d'un lignage unique. Les premiers constituent le patriclan (gorol), et les seconds le matriclan (dewol) de ce lignage (lenyol) commun.
36. Il s'agit des descendants de Sarakolle et Toucouleur razziés par leurs voisins Maures et réduits en esclavage, qui se voyaient donc imprimer la civilisation des maîtres. Ces esclaves noirs dits OrmankooBe ou TagankooBe — du nom des pays maures dont ils reviennent — se trouvent affranchis par le fait de leur fuite, donc rupture d'avec le maître : taJde-Boggol c'est rompre unilatéralement la corde symbolique qui lie au maître. Réintégrant leur pays d'origine, ces esclaves sans maîtres se reconvertissent aux coutumes locales. N'étant tenus à aucun interdit de caste ni à nulle spécialité professionnelle, ils pratiquent tous les métiers et à leur profit exclusif. Ils seront généralement puisatiers, passeurs, pêcheurs, cultivateurs, bouchers, et plus récemment maçons et boulangers. Ils forment isolat, ou bien ils se marient avec les esclaves des Toucouleur : dans ce dernier cas, si l'esclave toucouleur n'est pas affranchi(e) son maître conserve des droits sur les enfants issus du ménage.
37. La légende rapporte qu'une femme maabo et une femme tooroodo (clan des Sal) auraient, par erreur, procédé à la substitution de leurs bébés, chacune des mères emportant comme sien l'enfant de l'autre : c'est bien une autre forme du pacte du sang.
39. Désigne le cou au sens courant du mot ; dans ce contexte daande prend un sens technique de boucherie.
40. Ecume au sens propre. Au sens figuré s'emploie pour désigner toute personne qui présente la légèreté et l'errance de l'écume.
41. Oeuf ; c'est par conséquent, au sens figuré, la personne dont l'esprit est bouché comme l'oeuf est clos.
42. La preuve de supériorité était capitale, car jadis la simple visite du jyaaDo à son dimo créait à celui-ci l'obligation du don au profit de celui-là. Et n'ayant rien à offrir, le dimo devait quand même remettre symboliquement quelque chose de lui-même à son visiteur sacré lorsque celui-ci prenait congé, en l'occurrence une poignée du sable de sa maison. Faute d'avoir assumé effectivement ou symboliquement cette supériorité en se privant au bénéfice de l'inférieur, le dimo s'exposait dans la journée même à une réparation tragique, à savoir décès d'un membre de sa famille, par exemple.
43. Koran, sourate IV, versets 26, 27 et 28 notamment.
44. Hadema sooytude sooynde janannde sooytu sooyndema tawo.
45. La bru est en tout cas strictement tenue à cette clause de style, car il lui est prescrit de ne pas prononcer notamment les anthroponymes de ses beau-père, belle-mère et mari, sous peine de les vouer à une mort prématurée. Ce tabou de l'anthroponyme semble encore plus radical en ce qui concerne le mari, que son épouse baptisera joom galle (chef de la famille), baamum sukaaBam (père de mes enfants), etc. L'épouse est tellement contrainte à « l'oubli » du prénom de son mari, que si elle avait affaire à un homonyme de celui-ci elle le rebaptisera immédiatement, pour n'avoir pas à commettre l'erreur fatale de nommer même indirectement son époux.
Sans doute, ce tabou de l'anthroponyme est en lente éclipse comme sa destination première : il s'agissait pour la femme de marquer son respect (soowde) à des personnes qui lui étaient pour ainsi dire supérieures. Or, le nom de baptême du supérieur est trop sacré pour que l'inférieur soit autorisé à en user, parce que ce serait galvauder d'une certaine manière voire récuser indûment ladite supériorité.
46. Si tu es incapable de garder une femme ne l'avilis pas: rends-lui plutôt la liberté.